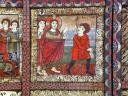« La protection de la vérité dans les discours de S.S. le Pape Jean-Paul II à la Rote romaine (1979-2005) », Bibliothèque de Philosophie Comparée (revue en ligne) n° spécial consacré à la pensée de Jean-Paul II, novembre 2005. L’article est disponible sur mon site.

Dans cet article, j’ai voulu montrer comme le pape Jean-Paul II (1978-2005) a envisagé la protection de la vérité dans les procès canoniques, précisément dans les vingt-cinq discours qu’il a adressés à la Rote romaine.
Voici la structure de l’article :
Introduction
I. Les exigences de la vérité
A) Le champ de la vérité
B) les fondements de la vérité dans les causes matrimoniales
II. La vérité dans les procès en déclaration de nullité de mariage
A) Le ministerium veritatis du juge
B) Les autres acteurs du procès
Conclusion
Depuis Pie XII, le pape a pour usage de s’adresser au doyen et aux juges auditeurs du tribunal de la Rote romaine, à un rythme qui est devenu pratiquement annuel sous Paul VI.
La Rote romaine est le tribunal ordinaire du Siège apostolique – gouvernement central de l’Église catholique – destiné à recevoir les appels des tribunaux inférieurs.
Les thèmes abordés dans ces discours sont variés, même s’ils ont souvent trait au droit matrimonial. On peut les résumer comme suit :
Pie XII
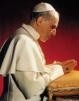
Droit au mariage, déclaration de nullité des mariages et dissolution du lien (3 octobre 1941)
Qualités de la certitude morale — fondée sur des motifs objectifs — que le juge doit acquérir pour prononcer une sentence (1er octobre 1942)
La fin unique dans l'examen des causes matrimoniales (2 octobre 1944)
Différences essentielles entre les procédures judiciaires ecclésiastique et civile (2 octobre 1945)
Défense de la foi et liberté des conversions (6 octobre 1946)
Différences essentielles entre la finalité de la société ecclésiastique et celle de la société civile (29 octobre 1947)
Les règles objectives du droit selon les principes chrétiens (13 novembre 1949)
Jean XXIII

L'histoire de la Rote, tribunal de la famille chrétienne (19 octobre 1959)
La sainteté du mariage est menacée (25 octobre 1960)
L'indissolubilité du mariage (13 décembre 1961)
Paul VI

La préparation au mariage (16 décembre 1963)
Le culte de la justice dans les tribunaux ecclésiastiques (11 janvier 1965)
La fonction pastorale du juge ecclésiastique. Le juridisme (25 janvier 1966)
La justice comme fondement de la vie sociale (23 janvier 1967)
Le service que la Rote rend à l'Église et au Pontife romain (12 février 1968)
L'autorité dans l'Église. Le juridisme (27 janvier 1969)
Le pouvoir judiciaire dans l'Église et les objections qui lui sont faites (29 janvier 1970)
L'exercice de l'autorité dans l'Église (28 janvier 1971)
Nécessité et révision du droit canonique (28 janvier 1972)
Nature pastorale du droit dans l'Église et équité canonique (8 février 1973)
Le caractère sacré de la fonction du juge (31 janvier 1974)
Protection des valeurs intangibles et sollicitude pastorale dans l'activité judiciaire. Le motu propio Causas matrimoniales (30 janvier 1975)
Réalité juridique et amour dans le mariage (9 février 1976)
Les conditions d'une procédure canonique au service du salut des âmes (28 janvier 1978)
Jean-Paul II

L'Église, rempart des droits de la personne (17 février 1979)
Les procès en nullité de mariage (4 février 1980)
Sauvegarder les valeurs du mariage (24 janvier 1981)
Reconnaître la valeur du mariage (28 janvier 1982)
Les instances juridiques dans la communion ecclésiale (26 février 1983)
Faire entrer le nouveau code de droit canonique dans la pratique de l'Église (26 janvier 1984)
Au service de la justice et de la vérité (30 janvier 1986)
La difficile recherche des causes psychologiques de nullité du mariage (5 février 1987)
Le défenseur du lien au service de la vision chrétienne du mariage (25 janvier 1988)
Le droit à la défense est garanti et réglementé par la loi (26 janvier 1989)
La dimension pastorale du droit canonique (18 janvier 1990)
Proposer dans son intégrité la doctrine évangélique sur le mariage (28 janvier 1991)
Immutabilité de la loi divine, stabilité du droit canonique et dignité de l'homme (23 janvier 1992)
Ne pas dénaturer la loi canonique sous prétexte d'humaniser le droit (30 janvier 1993)
La splendeur de la vérité et de la justice (28 janvier 1994)
La personne humaine au centre du ministerium iustitiæ (10 février 1995)
Le juge doit veiller au caractère particulier de chaque cas (22 janvier 1996)
Le droit canonique protège la réalité anthropologique et théologique du mariage (27 janvier 1997)
Le droit canonique est au service de l'unité dans la charité (17 janvier 1998).
La nature du mariage (21 janvier 1999).
Le mariage sacramentel conclu et consommé ne peut jamais être dissous, même pas par le pape (21 janvier 2000).
2001).
2002).
Le rapport particulier du mariage des baptisés au mystère de Dieu (30 janvier 2003).
La présomption de la validité du mariage (29 janvier 2004)
Les sentences injustes ne sont pas une solution pastorale (29 janvier 2005)
Benoît XVI

L’amour de la vérité à la jonction du droit et de la pastorale (28 janvier 2006)
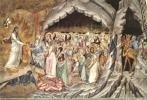


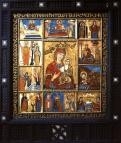
 Une précision terminologique tout d’abord. Incarnation vient du latin in « dans » et caro « chair ». « Reprenant l’expression de saint Jean (« Le Verbe s’est fait chair » : Jean 1, 14), l’Église appelle « Incarnation » le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle notre salut » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 461) : « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme » (credo de Nicée-Constantinople).
Une précision terminologique tout d’abord. Incarnation vient du latin in « dans » et caro « chair ». « Reprenant l’expression de saint Jean (« Le Verbe s’est fait chair » : Jean 1, 14), l’Église appelle « Incarnation » le fait que le Fils de Dieu ait assumé une nature humaine pour accomplir en elle notre salut » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 461) : « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme » (credo de Nicée-Constantinople).