
Là sera la véritable gloire ; personne n’y sera loué par erreur ou par flatterie ; les vrais honneurs ne seront ni refusés à ceux qui les méritent, ni accordés aux indignes ; d’ailleurs nul indigne n’y prétendra, là où ne seront admis que ceux qui sont dignes. Là régnera la véritable paix où nul n’éprouvera d’opposition ni de soi-même ni des autres. De la vertu, Dieu Lui-même sera la récompense, Lui qui a donné la vertu est S’est promis Lui-même à elle comme la récompense la meilleure et la plus grande qui puisse exister : « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple » (Lévitique 26, 12)… C’est aussi le sens des mots de l’Apôtre : « Pour que Dieu soit tout en tous » (1 Corinthiens 15, 28). Il sera Lui-même la fin de nos désirs, Lui que nous contemplerons sans fin, aimerons sans satiété, louerons sans lassitude. Et ce don, cette affection, cette occupation seront assurément, comme la vie éternelle, communs à tous.
La Cité de Dieu 22, 30.

Voici, d’après elle [l’Écriture], ce que nous ferons là-haut : toute notre occupation tiendra dans ces deux mots : Amen, Alleluia ! […] Amen veut dire : c’est vrai ; Alleluia veut dire : louez Dieu. […] Et quand nous dirons c’est vrai, c’est Amen que nous dirons, mais avec un rassasiement en quelque sorte insatiable. Comme rien ne manquera à l’âme, ce sera le rassasiement ; mais comme cette vérité qui ne nous manquera jamais, nous réjouira toujours, toujours elle produira, si je puis dire, un insatiable rassasiement ; et plus ce rassasiement sera insatiable de vérité, plus l’âme répétera avec une insatiable vérité : Amen ! Mais quelle merveille ! Et qui peut l’exprimer, quand l’œil ne l’a point vu, ni l’oreille entendu ; quand elle n’est pas montée encore au cœur de l’homme (1 Co 2, 9). Et parce que, sans le moindre ennui, et dans une délectation perpétuelle, nous contemplerons le vrai, parce qu’il brillera à nos yeux d’une invincible évidence, tout brûlants d’amour pour cette vérité, nous livrant à elle dans un délicieux et chaste embrassement, mais celui-là tout spirituel, nous ferons entendre le mot de la louange et nous dirons : Alleluia ! Et par l’effet de cette charité ardente que les habitants de la cité sainte ressentiront pour leurs frères et pour Dieu, tous, à l’envi, s’entraîneront à cette louange, et ils diront : Alleluia parce qu’ils diront : Amen !
Sermon 362 29.
Dominique Le Tourneau - Page 189
-
Le ciel vu par Saint Augustin
-
2 novembre : prier pour les morts
Novembre 2 : Suffrages pour les défunts
Du latin suffragium, « recommandation », « appui », le mot « suffrage » désignait jadis les antiennes, oraisons et versets de l’office commémoratif d’un saint, au jour de sa célébration. De nos jours, le terme est employé à propos des prières et des actes de culte, qui ont une valeur satisfactoire en faveur des fidèles défunts, c’est-à-dire les âmes du purgatoire. pour l’Église catholique, les justes, dont l'âme n'est pas entièrement purifiée des péchés véniels ou de la peine temporelle due pour les péchés déjà pardonnés en confession, doivent achever de se purifier au purgatoire, afin d'être prêts à entrer au ciel. Leurs souffrances peuvent être abrégées par les suffrages que les fidèles offrent à leur intention.
Il peut s’agir de la célébration d’une ou plusieurs messes, ou de messes grégoriennes ou trentain. Dans ce dernier cas, c’est une série de trente messes dites pour le repos de l’âme d’un défunt : elles doivent être célébrées pendant trente jours consécutifs, sans interruption. On les qualifie de messes grégoriennes, car le pape saint Grégoire le Grand (590-604) aurait obtenu d’une révélation de Dieu la promesse que, grâce au trentain, l’âme serait aussitôt délivrée du purgatoire, et admise au paradis. Le demandeur verse une offrande dont le montant est déterminé par les évêques.
Les indulgences peuvent également être offertes pour les âmes du purgatoire. L’indulgence est la « rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée [par la confession sacramentelle], rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées, par l’action de l’Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1471). C’est ce qui s’appelle la « réversibilité des mérites ». L’indulgence est plénière si elle remet totalement la peine, partielle dans le cas contraire. Elle peut être obtenue pour soi ou pour les âmes du purgatoire, défunts qui ne sont pas encore parvenus au ciel. Beaucoup d’actes de culte, de prières, d’objets bénis permettent d’obtenir des indulgences. Les années saintes sont des moments privilégiés pour les indulgences.
Par le biais des suffrages s’opère la réversibilité des mérites, les mérites de l’un étant reportés sur un autre, qui participe à la « communion des saints ». L’Église étant le « Corps mystique du Christ », et en raison de la communion des saints, elle peut « reverser » les mérites « de convenance » de certains de ses fidèles à d’autres qui en ont besoin.
« L’Église offre le sacrifice eucharistique pour les défunts, non seulement au moment des funérailles, mais aussi le jour anniversaire de leur mort, spécialement le troisième, ou le septième ou encore le trentième jour après leur décès. La célébration de la Messe pour le repos de l’âme d’un défunt, que l’on a connu sur cette terre, est la manière chrétienne de se souvenir et de prolonger, dans le Seigneur, la communion avec ceux qui ont franchi le seuil de la mort. De plus, le 2 novembre, l’Église réitère l’offrande du saint sacrifice pour tous les fidèles défunts, pour lesquels elle célèbre aussi la Liturgie des Heures » (Congrégation pour la Culte divin et la Discipline des sacrements, Directoire sur la piété populaire et la liturgie, 17 décembre 2001, n° 255).
Sauf autre indication, les définitions sont prises dans D. Le Tourneau, Les mots du christianisme, Paris, Fayard). -
28 octobre : saint Simon et saint Jude
Au cours de l'audience générale du mercredi 11 octobre 2006, le pape Benoît XVI a présenté la figure des apôtres saint Simon le Cananéen et saint Jude Thaddée :
Nous prenons aujourd'hui en considération deux des douze Apôtres: Simon le Cananéen et Jude Thaddée (qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote). Nous les considérons ensemble, non seulement parce que dans les listes des Douze, ils sont toujours rappelés l'un à côté de l'autre (cf. Mt 10, 4; Mc 3, 18; Lc 6, 15; Ac 1, 13), mais également parce que les informations qui les concernent ne sont pas nombreuses, en dehors du fait que le Canon néo-testamentaire conserve une lettre attribuée à Jude Thaddée.
Simon reçoit un épithète qui varie dans les quatre listes: alors que Matthieu et Marc le qualifient de "cananéen", Luc le définit en revanche comme un "zélote". En réalité, les deux dénominations s'équivalent, car elles signifient la même chose: dans la langue juive, en effet, le verbe qana' signifie: "être jaloux, passionné" et peut être utilisé aussi bien à propos de Dieu, en tant que jaloux du peuple qu'il a choisi (cf. Ex 20, 5), qu'à propos des hommes qui brûlent de zèle en servant le Dieu unique avec un dévouement total, comme Elie (cf. 1 R 19, 10). Il est donc possible que ce Simon, s'il n'appartenait pas précisément au mouvement nationaliste des Zélotes, fût au moins caractérisé par un zèle ardent pour l'identité juive, donc pour Dieu, pour son peuple et pour la Loi divine. S'il en est ainsi, Simon se situe aux antipodes de Matthieu qui, au contraire, en tant que publicain, provenait d'une activité considérée comme totalement impure. C'est le signe évident que Jésus appelle ses disciples et ses collaborateurs des horizons sociaux et religieux les plus divers, sans aucun préjugé. Ce sont les personnes qui l'intéressent, pas les catégories sociales ou les étiquettes! Et il est beau de voir que dans le groupe de ses fidèles, tous, bien que différents, coexistaient ensemble, surmontant les difficultés imaginables: en effet, Jésus lui-même était le motif de cohésion, dans lequel tous se retrouvaient unis. Cela constitue clairement une leçon pour nous, souvent enclins à souligner les différences, voire les oppositions, oubliant qu'en Jésus Christ, nous a été donnée la force pour concilier nos différences. Rappelons-nous également que le groupe des Douze est la préfiguration de l'Eglise, dans laquelle doivent trouver place tous les charismes, les peuples, les races, toutes les qualités humaines, qui trouvent leur composition et leur unité dans la communion avec Jésus.
En ce qui concerne ensuite Jude Thaddée, il est ainsi appelé par la tradition qui réunit deux noms différents: en effet, alors que Matthieu et Marc l'appellent simplement "Thaddée" (Mt 10, 3; Mc 3, 18), Luc l'appelle "Jude fils de Jacques" (Lc 6, 16; Ac 1, 13). Le surnom de Thaddée est d'une origine incertaine et il est expliqué soit comme provenant de l'araméen taddà, qui veut dire "poitrine" et qui signifierait donc "magnanime", soit comme l'abréviation d'un nom grec comme "Théodore, Théodote". On ne connaît que peu de choses de lui. Seul Jean signale une question qu'il posa à Jésus au cours de la Dernière Cène. Thaddée dit au Seigneur: "Seigneur, pour quelle raison vas-tu te manifester à nous, et non pas au monde?". C'est une question de grande actualité, que nous posons nous aussi au Seigneur: pourquoi le Ressuscité ne s'est-il pas manifesté dans toute sa gloire à ses adversaires pour montrer que le vainqueur est Dieu? Pourquoi s'est-il manifesté seulement à ses Disciples? La réponse de Jésus est mystérieuse et profonde. Le Seigneur dit: "Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui" (Jn 14, 22-23). Cela signifie que le Ressuscité doit être vu et perçu également avec le coeur, de manière à ce que Dieu puisse demeurer en nous. Le Seigneur n'apparaît pas comme une chose. Il veut entrer dans notre vie et sa manifestation est donc une manifestation qui implique et présuppose un coeur ouvert. Ce n'est qu'ainsi que nous voyons le Ressuscité.
à Jude Thaddée a été attribuée la paternité de l'une des Lettres du Nouveau Testament, qui sont appelées "catholiques" car adressées non pas à une Eglise locale déterminée, mais à un cercle très vaste de destinataires. Celle-ci est en effet adressée "aux appelés, bien-aimés de Dieu le Père et réservés pour Jésus Christ" (v. 1). La préoccupation centrale de cet écrit est de mettre en garde les chrétiens contre tous ceux qui prennent le prétexte de la grâce de Dieu pour excuser leur débauche et pour égarer leurs autres frères avec des enseignements inacceptables, en introduisant des divisions au sein de l'Eglise "dans leurs chimères" (v. 8), c'est ainsi que Jude définit leurs doctrines et leurs idées particulières. Il les compare même aux anges déchus et, utilisant des termes forts, dit qu'"ils sont partis sur le chemin de Caïn" (v. 11). En outre, il les taxe sans hésitation de "nuages sans eau emportés par le vent; arbres de fin d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés; flots sauvages de la mer, crachant l'écume de leur propre honte; astres errants, pour lesquels est réservée à jamais l'obscurité des ténèbres" (vv. 12-13).
Aujourd'hui, nous ne sommes peut-être plus habitués à utiliser un langage aussi polémique qui, toutefois, nous dit quelque chose d'important. Au milieu de toutes les tentations qui existent, avec tous les courants de la vie moderne, nous devons conserver l'identité de notre foi. Certes, la voie de l'indulgence et du dialogue, que le Concile Vatican II a entreprise avec succès, doit assurément être poursuivie avec une ferme constance. Mais cette voie du dialogue, si nécessaire, ne doit pas faire oublier le devoir de repenser et de souligner toujours avec tout autant de force les lignes maîtresses et incontournables de notre identité chrétienne. D'autre part, il faut bien garder à l'esprit que notre identité demande la force, la clarté et le courage face aux contradictions du monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi le texte de la lettre se poursuit ainsi: "Mais vous, mes bien-aimés, - il s'adresse à nous tous - que votre foi très sainte soit le fondement de la construction que vous êtes vous-mêmes. Priez dans l'Esprit Saint, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié..." (vv. 20-22). La Lettre se conclut sur ces très belles paroles: "Gloire à Dieu, qui a le pouvoir de vous préserver de la chute et de vous rendre irréprochables et pleins d'allégresse, pour comparaître devant sa gloire: au Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus Christ, gloire, majesté, force et puissance, avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles. Amen" (vv. 24-25).
On voit bien que l'auteur de ces lignes vit en plénitude sa propre foi, à laquelle appartiennent de grandes réalités telles que l'intégrité morale et la joie, la confiance et, enfin, la louange; le tout n'étant motivé que par la bonté de notre unique Dieu et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ. C'est pourquoi Simon le Cananéen, ainsi que Jude Thaddée, doivent nous aider à redécouvrir toujours à nouveau et à vivre inlassablement la beauté de la foi chrétienne, en sachant en donner un témoignage à la fois fort et serein.
© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana
Lien permanent Catégories : Apôtres et évangélistes, Histoire, Religion, Spiritualité, Théologie 0 commentaire -
L’obéissance de Jésus

« À faire ton bon plaisir, mon Dieu, je me complais » (Psaume 40 [39], 9). « Il dit : Voici que je viens pour faire ta volonté » (Hébreux 10, 9). Le Christ pour nous « s’est fait obéissant jusqu’à la mort, et à la mort sur la Croix » (Philippiens 2, 8).
Jésus-Christ « était soumis » (Luc 2, 51) à ses parents, comme n’importe quel enfant, plus que n’importe quel enfant, car il était « Dieu parfait et homme parfait » (Symbole d’Athanase). Il s’est soumis également à la Loi juive donnée au peuple élu par son Père : « Dieu envoya son Fils, né d’une femme, né sous la Loi,pour racheter ceux qui étaient sous la Loi, afin que nous recevions la qualité de fils » (Galates 4, 4). Et ils respectent les prescriptions liturgiquement rituelles, il se rend à la synagogue le jour du sabbat, et au Temple de Jérusalem à l’occasion des grandes fêtes.
Mais Jésus a compris vraiment ce qu’est l’obéissance dans les souffrances qu’il a endurées librement : « J’ai le pouvoir de la donner [ma vie] et j’ai le pouvoir de la recouvrer ensuite » (Jean 10, 18).
Il ne l’a pas apprise dans l’entrée triomphale à Jérusalem, quand, au comble de l’exaltation que soulevaient des considérations trop humaines, le peuple criait et chantait : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Jean 12, 13). Il ne l’a pas apprise non plus quand les foules émerveillées de la multiplication des pains et des poissons voulaient s’emparer de lui pour le proclamer roi à la place du monarque régnant (voir Jean 6, 15). Il ne l’a pas davantage apprise quand ses auditeurs constataient que « jamais homme n’a parlé comme cet homme » (Jean 7, 46), ni quand, admiratifs, ils s’exclamaient : « Il a tout fait à la perfection » (Marc 7, 37) et qu’ils rendaient grâces à Dieu parce qu’« un grand prophète a surgi parmi nous » (Luc 7, 16).

Non ! Mais c’est dans l’agonie, la Passion et sur la Croix que Jésus prend toute la mesure de l’obéissance. Son être résiste, éprouve de la répugnance pour ce Sacrifice, la peur et l’angoisse : « Mon âme est triste à en mourir » (Matthieu 26, 38). « Mon Père, si c’est possible que cette coupe passe loin de moi » (Matthieu 26, 39). Et Jésus transpire d’une sueur mêlée d’eau et de sang : « Sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre » (Luc 22, 44). Mais Jésus va jusqu’au bout. Il avait déjà demandé à son Père d’être « préservé de cette heure », ajoutant : « Mais c’est pour cela que je suis arrivé à cette heure » (Jean 12, 27). Aussi ajoute-t-il dans sa prière à Gethsémani : « Cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne » (Luc 22, 42).
Donner sa vie pour les autres : tel est le sens de la vie du Christ. Elle ouvre le chemin du chrétien, chemin de renoncement à soi dans les petites choses de la vie ordinaire, pour que la présence de la Croix aide à accomplir en tout la sainte volonté de Dieu, qui se ramène à nous sanctifier et à être apôtre, témoin du Christ et de l’Évangile, pour aider les autres à se sanctifier eux aussi.
« Jésus, qui s’est fait enfant — méditez bien cela — a vaincu la mort. Par son anéantissement, par sa simplicité, par son obéissance, par la divinisation de la vie courante et vulgaire des créatures, le Fils de Dieu s’est rendu vainqueur.
Voilà quel a été le triomphe de Jésus-Christ. C’est ainsi qu’il nous a élevés à sa hauteur, celle des enfants de Dieu, en descendant à notre niveau, celui des enfants des hommes » (saint Josémaria, Quand le Christ passe, n° 21). -
Filiation divine
En cette période de préparation à lanaissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, il peut être utile de réfléchir à notre filiation adoptive envers Dieu.

« Avant la création du monde, avant notre venue à l'existence, le Père céleste nous a choisis personnellement, pour nous appeler à entrer en relation filiale avec lui, par Jésus, Verbe incarné, sous la conduite de l'Esprit Saint. En mourant pour nous, Jésus nous a introduits dans le mystère de l'amour du Père, amour qui l'enveloppe totalement et qu'il nous offre à tous. De cette façon, unis à Jésus, qui est le Chef, nous formons un seul corps, l'Église.
Le poids de deux millénaires d'histoire rend difficile la perception de la nouveauté du mystère fascinant de l'adoption divine, mystère qui est au centre de l'enseignement de saint Paul. Le Père, rappelle l'Apôtre, « nous a dévoilé le mystère de sa volonté,… le dessein de réunir tout sous un seul chef le Christ » (Éphésiens 1, 9-10). Et il ajoute, non sans enthousiasme : « Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères » (Romains 8, 28-29). La perspective est vraiment fascinante : nous sommes appelés à vivre en frères et sœurs de Jésus, à nous sentir fils et filles du même Père. C'est un don qui bouleverse toute idée et tout projet exclusivement humains. La confession de la vraie foi ouvre grand les esprits et les cœurs à l'inépuisable mystère de Dieu, qui pénètre l'existence humaine » (Benoît XVI, Message pour la Journée mondiale de prière pour les vocations, 7 mai 2006).
C'est une des vérités fondamentales pour la vie chrétienne, en ce sens qu’elle devrait lui servir de fondement permanent. « Tous les hommes sont enfants de Dieu. Mais, face à son père, un enfant peut réagir de mille manières. À nous de nous efforcer, comme des enfants, de nous rendre compte que le Seigneur, en nous voulant pour enfants, nous fait vivre dans sa maison, au milieu de ce monde ; nous intègre à sa famille, fait nôtre ce qui est sien, et sien ce qui est nôtre ; nous vaut cette familiarité et cette confiance qui nous font lui demander, comme de petits enfants, l'impossible » (saint Josémaria,Lien permanent Catégories : Filiation divine, Jésus-Christ, Religion, Spiritualité, Théologie 0 commentaire -
Noël
Partout dans le monde, les chrétiens se recueillent en ce jour pour célébrer la naissance — la Nativité — d’un enfant, Jésus de Nazareth, qui allait se révéler être le Messie annoncé par les prophètes d’Israël, Celui qui devait venir racheter son peuple de ses péchés. C’est la naissance de celui qui est Dieu lui-même, le Fils de Dieu, qui veut naître aussi dans l’âme des hommes et y régner, ainsi que la solennité du Christ-Roi l’a rappelé récemment. Nous pouvons parler de trois naissances : « La première et la plus sublime naissance est celle du fils unique engendré par le Père céleste dans l’essence divine, dans la distinction des personnes. La seconde naissance fêtée aujourd’hui est celle qui s’accomplit par une mère qui dans sa fécondité garda l’absolue pureté de sa virginale chasteté. La troisième est celle par laquelle Dieu, tous les jours et à toute heure, naît en vérité spirituellement, par la grâce et l’amour, dans une bonne âme. Telles sont les trois naissances qu’on célèbre aujourd’hui par trois messes » (Jean Tauler, Sermon pour la fête de Noël).
Cette naissance de Jésus n’est pas seulement un événement qui s’inscrit dans l’histoire de l’humanité, à un moment bien précis, il y a de cela deux mille ans environ. C’est une réalité dont l’efficacité se prolonge dans le temps et qui oriente l’homme vers l’éternité. Mais pour cela, l’homme doit se mettre à la recherche de Dieu. Dieu ne s’impose pas et, de fait, à Bethléem les portes se ferment devant Marie et Joseph en quête d’un logement. Pour que Jésus naisse dans l’âme tous les jours, l’homme doit le vouloir. « Le jour de Noël, nous lisons que les bergers de Bethléem, qui furent les premiers appelés à venir voir le nouveau-né de la crèche, « y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire » (Lc 2, 16).

Arrêtons-nous sur le mot « trouvèrent » qui exprime la recherche. Les bergers de Bethléem, qui se reposaient avec leurs troupeaux, ne savaient pas, en effet, que le temps était arrivé où se réaliserait ce qui depuis des siècles était annoncé par les prophètes de leur peuple, et que cela aurait lieu cette nuit-même, tout près d’eux. Quand ils sont sortis du sommeil où ils étaient plongés, ils ne savaient ni ce qui était arrivé ni où cela était arrivé. S’ils sont parvenus à la grotte, c’est après une recherche. Mais en même temps, ils avaient été conduits. Comme nous le lisons, ils avaient été guidés par une voix et une lumière. Et si nous remontons plus haut dans le passé, nous voyons qu’ils avaient été guidés par la tradition de leur peuple, par son attente. Nous savons qu’Israël avait obtenu la promesse du Messie. […]
Ils ont cherché où il pouvait être, et finalement ils l’ont trouvé. Et en même temps, chez saint Luc, le mot « trouver » exprime la dimension intérieure de ce qui s’est passé chez ces simples bergers de Bethléem la nuit de Noël. […]
Le mot « trouver » exprime une recherche.
L’homme est un être qui cherche. Toute son histoire le confirme. La vie de chacun de nous en témoigne aussi. […] Parmi tous les domaines où l’homme se révèle comme un être qui cherche, il en est un, plus profond, qui pénètre plus intimement dans l’humanité même de l’être humain et qui correspond le mieux au sens de toute la vie humaine.
L’homme est l’être qui cherche Dieu » (Jean-Paul II, Audience générale, 27 décembre 1978). Depuis Noël, nous savons comment combler cette quête et cette soif de Dieu. -
saint Jean(3)
Jean, le Voyant de Patmos

[…] Aujourd'hui, nous revenons encore une fois sur la figure de l'apôtre Jean, en prenant cette fois en considération le Voyant de l'Apocalypse. Et nous faisons immédiatement une observation : alors que ni le Quatrième Évangile, ni les Lettres attribuées à l'apôtre ne portent jamais son nom, l'Apocalypse fait référence au nom de Jean, à quatre reprises (cf. 1, 1.4.9 ; 22, 8). Il est évident que l'Auteur, d'une part, n'avait aucun motif pour taire son propre nom et, de l'autre, savait que ses premiers lecteurs pouvaient l'identifier avec précision. Nous savons par ailleurs que, déjà au IIIe siècle, les chercheurs discutaient sur la véritable identité anagraphique du Jean de l'Apocalypse. Quoi qu'il en soit, nous pourrions également l'appeler « le Voyant de Patmos », car sa figure est liée au nom de cette île de la mer Égée, où, selon son propre témoignage autobiographique, il se trouvait en déportation « à cause de la Parole de Dieu et du témoignage pour Jésus » (Apocalypse 1, 9). C'est précisément à Patmos, « le jour du Seigneur... inspiré par l'Esprit » (Apocalypse 1, 10), que Jean eut des visions grandioses et entendit des messages extraordinaires, qui influencèrent profondément l'histoire de l'Église et la culture occidentale tout entière. C'est par exemple à partir du titre de son livre — Apocalypse, Révélation — que furent introduites dans notre langage les paroles « apocalypse, apocalyptique », qui évoquent, bien que de manière inappropriée, l'idée d'une catastrophe imminente.
Le livre doit être compris dans le cadre de l'expérience dramatique des sept Églises d'Asie (Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée), qui vers la fin du Ier siècle durent affronter des difficultés importantes — des persécutions et également des tensions internes — dans leur témoignage au Christ. Jean s'adresse à elles en faisant preuve d'une vive sensibilité pastorale à l'égard des chrétiens persécutés, qu'il exhorte à rester solides dans la foi et à ne pas s'identifier au monde païen si fort. Son objet est constitué en définitive par la révélation, à partir de la mort et de la résurrection du Christ, du sens de l'histoire humaine. La première vision fondamentale de Jean, en effet, concerne la figure de l'Agneau, qui est égorgé et pourtant se tient debout (cf. Apocalypse 5, 6), placé au milieu du trône où Dieu lui-même est déjà assis. À travers cela, Jean veut tout d'abord nous dire deux choses : la première est que Jésus, bien que tué par un acte de violence, au lieu de s'effondrer au sol, se tient paradoxalement bien fermement sur ses pieds, car à travers la résurrection, il a définitivement vaincu la mort; l'autre est que Jésus, précisément en tant que mort et ressuscité, participe désormais pleinement au pouvoir royal et salvifique du Père. Telle est la vision fondamentale. Jésus, le Fils de Dieu, est sur cette terre un agneau sans défense, blessé, mort. Toutefois, il se tient droit, il est debout, il se tient devant le trône de Dieu et participe du pouvoir divin. Il a entre ses mains l'histoire du monde. Et ainsi, le Voyant veut nous dire : Ayez confiance en Jésus, n'ayez pas peur des pouvoirs opposés, de la persécution ! L'Agneau blessé et mort vainc ! Suivez l'Agneau Jésus, confiez-vous à Jésus, prenez sa route! Même si dans ce monde, ce n'est qu'un Agneau qui apparaît faible, c'est Lui le vainqueur !
L'une des principales visions de l'Apocalypse a pour objet cet Agneau en train d'ouvrir un livre, auparavant fermé par sept sceaux que personne n'était en mesure de rompre. Jean est même présenté alors qu'il pleure, car l'on ne trouvait personne digne d'ouvrir le livre et de le lire (cf. Apocalypse 5, 4). L'histoire reste indéchiffrable, incompréhensible. Personne ne peut la lire. Ces pleurs de Jean devant le mystère de l'histoire si obscur expriment peut-être le sentiment des Églises asiatiques déconcertées par le silence de Dieu face aux persécutions auxquelles elles étaient exposées à cette époque. C'est un trouble dans lequel peut bien se refléter notre effroi face aux graves difficultés, incompréhensions et hostilités dont souffre également l'Église aujourd'hui dans diverses parties du monde. Ce sont des souffrances que l'Église ne mérite certainement pas, de même que Jésus ne mérita pas son supplice. Celles-ci révèlent cependant la méchanceté de l'homme, lorsqu'il s'abandonne à l'influence du mal, ainsi que le gouvernement supérieur des événements de la part de Dieu. Eh bien, seul l'Agneau immolé est en mesure d'ouvrir le livre scellé et d'en révéler le contenu, de donner un sens à cette histoire apparemment si souvent absurde. Lui seul peut en tirer les indications et les enseignements pour la vie des chrétiens, auxquels sa victoire sur la mort apporte l'annonce et la garantie de la victoire qu'ils obtiendront eux aussi sans aucun doute. Tout le langage fortement imagé que Jean utilise vise à offrir ce réconfort.
Au centre des visions que l'Apocalypse présente, se trouvent également celles très significatives de la Femme qui accouche d'un Fils, et la vision complémentaire du Dragon désormais tombé des cieux, mais encore très puissant. Cette Femme représente Marie, la Mère du Rédempteur, mais elle représente dans le même temps toute l'Eglise, le Peuple de Dieu de tous les temps, l'Église qui, à toutes les époques, avec une grande douleur, donne toujours à nouveau le jour au Christ. Et elle est toujours menacée par le pouvoir du Dragon. Elle apparaît sans défense, faible. Mais alors qu'elle est menacée, persécutée par le Dragon, elle est également protégée par le réconfort de Dieu. Et à la fin, cette Femme l'emporte. Ce n'est pas le Dragon qui gagne. Voilà la grande prophétie de ce livre qui nous donne confiance. La Femme qui souffre dans l'histoire, l'Église qui est persécutée, apparaît à la fin comme une Epouse splendide, figure de la nouvelle Jérusalem, où il n'y a plus de larmes, ni de pleurs, image du monde transformé, du nouveau monde, dont la lumière est Dieu lui-même, dont la lampe est l'Agneau.
C'est pour cette raison que l'Apocalypse de Jean, bien qu'imprégnée par des références continues aux souffrances, aux tribulations et aux pleurs — la face obscure de l'histoire —, est tout autant imprégnée par de fréquents chants de louange, qui représentent comme la face lumineuse de l'histoire. C'est ainsi, par exemple, que l'on lit la description d'une foule immense, qui chante presque en criant : « Alléluia ! le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté, lui, le Tout-Puissant. Soyons dans la joie, exultons, rendons-lui gloire, car voici les noces de l'Agneau. Son épouse a revêtu ses parures » (Apocalypse 19, 6-7). Nous nous trouvons ici face au paradoxe chrétien typique, selon lequel la souffrance n'est jamais perçue comme le dernier mot, mais considérée comme un point de passage vers le bonheur, étant déjà même mystérieusement imprégnée par la joie qui naît de l'espérance. C'est précisément pour cela que Jean, le Voyant de Patmos, peut terminer son livre par une ultime aspiration, vibrant d'une attente fervente. Il invoque la venue définitive du Seigneur : « Viens, Seigneur Jésus ! » (Apocalypse 22, 20). C'est l'une des prières centrales de la chrétienté naissante, également traduite par saint Paul dans la langue araméenne : « Marana tha ». Et cette prière, « Notre Seigneur, viens ! » (1 Corinthiens 16, 22), possède plusieurs dimensions.
Naturellement, elle est tout d'abord l'attente de la victoire définitive du Seigneur, de la nouvelle Jérusalem, du Seigneur qui vient et qui transforme le monde. Mais, dans le même temps, elle est également une prière eucharistique : « Viens Jésus, maintenant ! » Et Jésus vient, il anticipe son arrivée définitive. Ainsi, nous disons avec joie au même moment: « Viens maintenant, et viens de manière définitive ! » Cette prière possède également une troisième signification : « Tu es déjà venu, Seigneur ! Nous sommes certains de ta présence parmi nous. C'est pour nous une expérience joyeuse. Mais viens de manière définitive ! » Et ainsi, avec saint Paul, avec le Voyant de Patmos, avec la chrétienté naissante, nous prions nous aussi : « Viens, Jésus ! Viens, et transforme le monde ! Viens dès aujourd'hui et que la paix l'emporte ! » Amen ! -
15 novembre : saint Albert le Grand

C’est aujourd’hui le dies natalis, le « jour de la naissance » au ciel de saint Albert le Grand, né en 1206 et décédé le 15 novembre 1280. De son vrai nom Albert de Bollstaedt, il entra dans l’ordre des frères prêcheurs (les Dominicains), malgré la vive opposition de sa famille. Il se consacra très vite à l’enseignement dans divers couvents, avant d’être nommé Régent du studium generale, le centre d’études supérieures de l’ordre qui venait d’ouvrir à Cologne, où il fut le professeur du futur saint Thomas d’Aquin (lire la suite) -
18 octobre : saint Luc
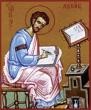
Saint Luc est l’auteur du troisième Évangile, comme l’attestent de nombreux témoignages des Pères de l’Église, sans compter les manuscrits eux-mêmes : le papyrus Bodmer XIV (P66), daté de 175-225 a pour titre Euangelion katá Loukan, « Évangile selon Luc », et contient Luc 1,1 à 14, 26. Saint Irénée écrit dans son Adversus hæreses, « Contre les hérétiques », que « Luc, le compagnon de Paul, a consigné en un livre l’évangile prêché par celui-ci ».
Le nom de Luc apparaît à trois reprises dans le Nouveau Testament, et il s’agit toujours d’un collaborateur de Paul. « Tu as les salutations […] de Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs » (épître à Philémon 24). « Seul Luc est avec moi » (2 Timothée 4, 11). Le dernier texte précise que Luc est médecin : « Vous avez les salutations de Luc, le cher médecin » (Colossiens 4, 14).
Luc n’a pas été le témoin oculaire des faits qu’il rapporte, comme il ledit lui-même en introduction à son Évangile : « Puisque beaucoup ont entrepris décomposer un récit des événements quichenotte accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j’ai décidé, moi aussi, après m’être informé soigneusement de tout depuis les origines, d’en écrire pour toi l’exposé suivi, illustre Théophile, afin que tu te rendes compte de la solidité des enseignements que tu as reçus » (1, 1-4).
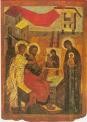 Il n’est pas d’origine palestinienne ; il est cultivé ; le langage qu’il utilise et la doctrine qu’il expose sont proches du corps doctrinal paulinien (de saint Paul) ; il connaît bien la communauté chrétienne d’Antioche. Il est probablement né dans cette ville et fait partie des chrétiens de la deuxième génération.
Il n’est pas d’origine palestinienne ; il est cultivé ; le langage qu’il utilise et la doctrine qu’il expose sont proches du corps doctrinal paulinien (de saint Paul) ; il connaît bien la communauté chrétienne d’Antioche. Il est probablement né dans cette ville et fait partie des chrétiens de la deuxième génération.
Il est également l’auteur des Actes des apôtres, qui reprennent la narration des faits là où son Évangile s’était arrêté, c’est-à-dire au moment de l’Ascension de Jésus au ciel. Il y raconte la naissance de l’Église,avec la venue du Saint-Esprit le jour de la pentecôte, son implantation et sa propagation. Il ne s’agit toutefois pas d’une simple chronique des événements : Luc montre que la mission du christ se poursuit avec les apôtres sous l’impulsion du Saint-Esprit. Celui-ci est tellement présent que les actes ont été qualifiés d’Évangile du Saint-Esprit. Le livre se compose de quatre grandes parties : la communauté primitive de Jérusalem (chap. 1-7), la dispersion des chrétiens à la suite des persécutions (chap. 8-12), l’entreprise missionnaire de saint Paul (chap. 13-20), la captivité de Paul à Jérusalem et à Rome (chap. 21-28).
On peut penser que saint Luc a achevé d’écrire son Évangile au début de l’année 63 et qu’il a terminé les Actes à la fin de cette même année63. -
3ème mystère douloureux : le couronnement d’épines

Il faut que l’Amour du Christ soit grand — démesuré à la démesure de sa condition infinie de Fils de Dieu — pour accepter de supporter de telles avanies.
C’est un acte de cruauté inutile. Dans l’état dans lequel il se trouvait, Jésus était déjà un homme mort… Mais il est la proie facile d’une garnison désœuvrée.
Dans leur méchanceté, les soudards sont malgré tout l’instrument dont Dieu se sert pour faire connaître une réalité profonde : la royauté du Christ. Certes, ils prennent cela sur le ton burlesque. Mais Jésus est bien roi. Il l’a expliqué à Pilate qui lui demandait : « C’est toi qui est le roi des Juifs ? » Jésus répond sans ambages : « Mon royaume n’est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs » (Jean 18, 32-35). En effet, il aurait pu invoquer son Père, qui lui « fournirait immédiatement douze légions d’anges et plus » (Matthieu 26, 53). « Non, mon royaume n’est pas de ce monde. « Alors lui dit Pilate : « C’est donc que tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui le dit : je suis roi. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde à seule fin de rendre témoignage à la Vérité. Quiconque est du parti de la vérité écoute ma voix » (Jean 18, 36-38). Ce ne sera pas le cas de Pilate, qui précisément livre Jésus à ses soldats pour qu’ils lui administrent une correction sévère. Les sévices gratuits peuvent sembler inutiles. Mais comme tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu (cf. Romains 8, 28), quand c’est le Fils de Dieu qu’ils blessent, ils servent à sauver du péché tous les hommes et les femmes qui acceptent l’Amour du Christ et de le reconnaître pour ce qu’il est : le Fils de Dieu incarné.
Les soldats, « après lui avoir retiré ses vêtements, jetèrent sur lui une clamyde rouge, tressèrent une couronne d’épines et la lui posèrent sur la tête, avec un roseau dans la main droite » (Matthieu 27, 28-29). Ils peuvent tourner Jésus en ridicule et faire des génuflexions grotesques : « Fléchissant le genou devant lui, ils le tournaient en dérision, disant : « Salut, ô roi des Juifs ! » Ils lui crachaient aussi dessus et, prenant le roseau, ils le frappaient à la tête » (Matthieu 27, 29-30). Ils n’en proclament pas moins une grande vérité. C’est « au nom de Jésus que [tout] genou fléchit dans le monde céleste, terrestre et infernal », toute langue devant « proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » (Philippiens 2, 10-11).
 Pilate dit alors aux Juifs, sur un ton de moquerie : « Voilà votre roi ! » Ce à quoi les grands prêtres répliquèrent : « Nous n’avons d’autre roi que César » (Jean 19, 15-16). Machiavel dira qu’il aimait plus sa patrie que son âme…
Pilate dit alors aux Juifs, sur un ton de moquerie : « Voilà votre roi ! » Ce à quoi les grands prêtres répliquèrent : « Nous n’avons d’autre roi que César » (Jean 19, 15-16). Machiavel dira qu’il aimait plus sa patrie que son âme…
Pilate persiste et signe dans son ironie. Il fait placer en-haut de la Croix un écriteau rédigé « en hébreu, en latin et en grec » (Jean 19, 20), de sorte que l’univers entier sache que « le seigneur est roi, il règne éternellement » (Psaume 29, 10). Dans l’âme de chaque baptisé, la royauté du Christ est appelée à s’étendre au monde entier. Son royaume est, en effet, spirituel. C’est un « règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix » (préface de la solennité du Christ-Roi).