
Je conseille la lecture du livre de Janne Haaland MATLARY, Quand raison et foi se rencontrent, publié par les Presses de la Renaissance en 2003. L'auteur est norvégienne, issue d'un milieu luthérien, mais personnellement agnostique, c'est-à-dire étrangère à la connaissance de Dieu, dans un pays où le catholicisme était considéré avec mépris. Docteur en philosophie, elle se spécialise dans les relations internationales, qu'elle enseigne à l'université d'Oslo.

Elle découvre peu à peu ce qu'est le catholicisme. Toute agnostique qu'elle soit, elle comprend que le catholicisme est "fondé sur une personne qui se proclamait aussi vivante aujourd'hui que deux mille ans auparavant", et qu'il "existe une réalité objective dans l'hostie après la consécration, malgré ce que j'en pense ; que j'y croie ou non".
Après sa conversion au catholicisme en 1982, Matlary ne découvre que progressivement que la foi ne doit pas se cantonner à la prière, mais imprégner toute sa vie, d'épouse, de mère de quatre enfants, d'enseignante, de femme engagée dans la vie publique (elle sera secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de Norvège), de catholique (elle dirigera la représentation du Saint-Siège au congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, à Yokohama en 2001). C'est ce combat pour unifier toutes les composantes de l'existence que l'auteur nous livre, un combat qui connaît des hauts et des bas. L'auteur avoue avoir mis des années à comprendre que "le Christ nous offre chaque jour ses sacrements, qui sont là pour nous aider à entretenir et à améliorer nos relations avec Lui. Sans leur recours, on ne pourrait pas y arriver. Sans viligance, nous risquons de nous laisser entraîner dans la paresse, la volupté, le matéralisme et l'égocentrisme".
Bref, avec Mme Matlary, nous comprenons que "le Christ incarné n'est pas uniquement mon Dieu personnel, mon ami, mais que nous sommes tous inclusdans cette relation d'amour, le monde aussi. La sanctification de soi, celle des autres et celle du monde font partie d'un seul et même processus. Ma vocation porte le nom de chacun de mes enfants, de mon travail, de ma famille — bref, mon cheminement est fait de l'ordinaire de ma vie. Cet ordinaire est extraordinaire : c'est là que le Christ est présent".
L'ouvrage est préfacé par Michel Camdessus.
À lire.
Dominique Le Tourneau - Page 179
-
Un livre tonifiant
-
La Passion et saint Marc (1)
Réfléchissant à la Passion de Jésus-Christ, j’ai imaginé de l’envisager du point de vue de l’évangéliste Marc, qui se trouve présent au Jardin des Oliviers, au moment de l’arrestation de Jésus. Voici le produit de cette méditation, qui imagine le récit que Marc peut nous donner des événements, et fait partie d’un ouvrage inédit de ma composition :
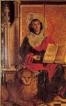
Marc est un homme discret et efficace. Il habite Jérusalem. Il appartient à une famille de condition aisée. Sa mère est veuve. Tous deux se lient très tôt d’amitié avec Jésus et avec le groupe de ses disciples. Cette amitié est providentielle, car elle va servir les desseins de Dieu. Marc est devenu, lui aussi, disciple du Nazaréen.
Les spécialistes s’accordent pour dire que le Cénacle appartenait à la mère de Marc, et probablement aussi le Jardin des Oliviers. Ceci explique que le Seigneur s’y rend souvent avec ses apôtres, à la tombée de la nuit, à un moment où il n’y a plus personne sur place et où ils peuvent donc être tranquilles pour prier et pour parler entre eux. Il n’est pas rare que Marc aille les rejoindre. Il est chez lui… C’est ce qu’il fait le Jeudi Saint.
Ce soir-là, Marc respecte l’intimité du Maître et de ses apôtres. Il a donné toutes sortes de facilités pour les préparatifs de la Pâque. Il s’est montré aussi coopératif que possible.
Quand il accompagnera Paul et son cousin Barnabé, puis Barnabé tout seul, et enfin Pierre, à Rome, il pourra confier tout ce qu’il a vécu aux premières communautés chrétiennes.
— « Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur (2 P 1, 2). J’ai le projet de rédiger un récit de la Bonne Nouvelle, comme Lévi, fils d’Alphée (Mc 2, 14) l’a déjà fait à l’intention des saints issus du judaïsme. Cela vous servira d’aide-mémoire.
« Pour l’heure, plaçons-nous au jour où notre Seigneur a pris son dernier repas avec les douze, avant d’être arrêté et mis en Croix. J’étais là. Ça se passait chez moi, au Cénacle, à Jérusalem. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie d’accueillir Jésus sous mon toit. C’est un honneur que je ne méritais pas. J’étais transporté d’allégresse. Mais si j’avais su que le Maître allait instituer les sacrements de l’ordre et de l’Eucharistie au cours de cette soirée, j’en aurais été encore plus émerveillé et fier.
« Je n’étais pas dans la salle du repas, bien entendu. Ce n’était pas ma place. Mais je les ai vus arriver. Le Maître m’a donné le baiser de paix avec beaucoup d’affection, et je le lui ai bien rendu ! Enfin, comme j’ai pu. Parce qu’il est impossible de rivaliser avec l’amour du Christ. C’était un baiser authentique. Comme un baiser à l’âme ! On sentait tout de suite le cœur brûler. On éprouvait très fortement l’envie de répondre de son mieux, d’être un digne fils de Dieu.


« Donc Jésus m’a salué. J’ai versé de l’eau bien fraîche sur ses pieds et les ai essuyés et embrassés avec affection, me souvenant de ce que dit le prophète : Qu’ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager qui publie la paix ; du messager de la bonne nouvelle, qui publie le salut ! (Is 52, 7).
« Puis j’ai versé de l’huile parfumée sur sa tête. Jésus a salué maman, qui avait veillé à ce que rien ne manque, d’après les instructions de Pierre et de Jean, venus dans la matinée pour préparer la Pâque (Lc 22, 8). Une fois qu’ils ont été installés, et après nous être assurés qu’ils n’avaient besoin de rien, maman et moi nous sommes allés manger aussi la Pâque chez des voisins, comme chaque année. En effet, dans l’Ancienne Alliance, le Seigneur Dieu a disposé au temps de Moïse que, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra en commun avec le voisin le plus proche, selon le nombre de personnes (Ex 12, 4). »
Marc doit reprendre sa respiration. Chaque fois qu’il pense à ces événements, il ne peut s’empêcher d’être ému.
— « Excusez-moi, dit-il, en renouant le fil de son récit, mais je ne peux pas évoquer ces moments sans émoi. Vous rendez-vous compte ? Jésus est chez moi ! Le Fils du Très-Haut, qu’il soit béni ! le Messie fait homme dans le sein très pur de la bienheureuse Vierge Marie ! Chez moi ! Il n’y a pas grand monde qui peut en dire autant. La belle-mère de Pierre, au bord du lac, à Capharnaüm. Marthe, Marie et Lazare, à Béthanie. Mais, je n’en connais pas beaucoup d’autres. J’y vois une grande grâce. Et puis, comme vous le savez, c’est au cours de ce repas que le Christ prit du pain, et après avoir prononcé la kidoush, une bénédiction, il le rompit, et le leur donna [à ses apôtres], en disant :
— « Prenez, ceci est mon corps. »
Il prit ensuite la coupe, et, ayant rendu grâces, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit :
— « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour la multitude » (Mc 14, 22-24). »
Ce que Marc ne peut pas relater, c’est qu’à ce moment-là, tous les anges du paradis ont embouché leur trompette argentine pour proclamer à la face de l’univers la grande nouvelle, l’invention divine de Dieu désormais présent, réellement présent, dans le très saint-sacrement !
— « Puis Jésus a commencé son action de grâces à voix haute pour cette première messe et cette première communion à son Corps. C’est moi qui suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron […]. Demeurez en moi, et moi [je demeurerai] en vous (Jn 15, 1.4). Puis il s’est mis à vanter les mérites de la charité sincère, authentique : Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés : demeurez dans cet amour que j’ai pour vous. Si vous mettez mes commandements en pratique, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi j’ai mis en pratique les commandements de mon Père et que je demeure en son amour (Jn 15, 9-10). Et il est revenu sur ce que nous pourrions appeler son « testament spirituel » : Voici quel est mon commandement : que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés (Jn 15, 12). »
« Il a poursuivi longuement. Si bien que nous étant dépêchés de rentrer, maman et moi, pour être sur place avant le départ de Jésus et des siens, de fait ils étaient encore là, fort heureusement. Comme je l’ai dit, Jésus était en train de parler. Nous entendions le bruit de sa voix, si familière, sans comprendre les paroles. Bien sûr, je ne l’ai pas dérangé. J’ai su plus tard qu’il faisait la prière que je viens de rappeler, en s’adressant à son Père. C’est ce que nous connaissons sous le nom de « prière sacerdotale » de Jésus. »
(à suivre…) -
Saint Walfroy
Saint Walfroy (VIème s.)
Je suis à Saint-Walfroy, ce qui me donne l’occasion de parler de ce saint.
Saint Walfroy, ou Wulfilaic, ou Wolf, ou Vulfe, est le seul « stylite » d’0ccident. Originaire de Lombardie, il avait entendu parler des vertus et de la sainteté de saint Martin qu’il prit comme modèle. Il se rendit à Limoges où Arédius, l'abbé du monastère de Saint Yrieix, le conduisit lui-même à Tours, à la basilique de saint Martin. Vers 585, il s’établit dans le diocèse de Trêves qui s'étendait jusque dans les environs de Reims et dont une grande partie de la population était encore païenne.
Il éleva une colonne non loin du temple de Diane, la « Dea Arduina » (qui a donné son nom aux Ardennes). Il vécut sur cette colonne durant des années « avec de grandes souffrances, sans aucune espèce de chaussure; et lorsqu'arrivait, le temps de l'hiver, j'étais tellement brûlé des rigueurs de la gelée que très-souvent elles ont fait tomber les ongles de mes pieds, et l'eau glacée pendait à ma barbe en forme de chandelles; car cette contrée passe pour avoir souvent des hivers très-froids ». Il obtint que les habitants du lieu démolissent la colonne élevée en l’honneur de Diane, non sans une intervention divine.
Un jour l'évêque du lieu déclara a Walfroy, comme l’historien saint Grégoire de Tours, rencontré à Trêves le rapporte dans son Histoire des Francs (vol. 1, livre 8) : « La voie que tu suis n'est pas la bonne. Tu n'as pas à te comparer à Siméon d'Antioche (qu'on appelle actuellement saint Syméon le Stylite). La rigueur du climat ne te le permet pas. » Il y envoya des ouvriers avec des haches, des ciseaux et des marteaux, et fit renverser la colonne.

Walfroy obéit et rejoignit le monastère le plus proche : « L'obéissance est plus chère à Dieu que le sacrifice. […] Depuis lors j'habite ici et je suis content d'habiter avec les frères. »
Parmi les nombreux miracles que mentionne saint Walfroy, citons celui-ci : « Le fils d'un Franc, homme très noble parmi les siens, était sourd et muet. Les parents de l'enfant l'ayant amené à cette basilique, j'ordonnai qu'on lui mît un lit dans ce temple saint pour le coucher avec mon diacre et un autre des ministres de l'église. Le jour il vaquait à l'oraison, et la nuit, comme je l'ai dit, il dormait dans la basilique. Dieu eut pitié de lui et le Bienheureux Martin m'apparut dans une vision et me dit : « Fais sortir l'agneau de la basilique, car il est guéri. » Le matin arrivé, comme je croyais que c'était un songe, l'enfant vint vers moi, se mit à parler, et commença à rendre grâces à Dieu ; puis, se tournant vers moi, il me dit : « J'offre mes actions de grâces au Dieu tout-puissant qui m'a rendu la parole et l'ouïe ». Dès ce moment il recouvra la parole et retourna dans sa maison. »
Mort peu avant l’an 600, saint Walfroy fut inhumé dans l’église qu’il avait construite, mais ses reliques furent transportées par la suite à Carignan.
La propriété, rachetée par l’archevêque de Reims en 1855, devient un ermitage confié à des Lazaristes en 1868. L’église actuelle date d’après la deuxième guerre mondiale. Après diverses activités, l’ermitage saint Walfroy est tenu depuis 2002 par une association qui cherche à y réaliser la vocation que saint Walfroy lui inspire « pour une Europe chrétienne ».

-
Les religions du Livre
Il est fréquent d’entendre parler des religions du Livre à propos du judaïsme, du christianisme et de l’islam. Ce nom est en réalité donné par les musulmans aux religions qui s’appuient sur un texte sacré : Tora pour le judaïsme, Bible pour le christianisme. Nous y ajoutons parfois l’islam lui-même, avec le Coran.
En réalité, il est tout à fait discutable de dire que les trois religions monothéistes, croyant en un seul Dieu, sont des « religions du Livre ». En effet, plus qu’une religion du Livre, le christianisme est la religion du Verbe, ou Parole de Dieu incarnée, Jésus-Christ, qui vient attester en personne la réalité de Dieu, et révéler l’existence de la Sainte Trinité, Dieu unique en trois Personnes, en même temps que donner sa vie pour le salut du monde, pour délivrer les hommes des chaînes du péché.
« Le Coran, selon la foi islamique, est une parole donnée oralement par Dieu, sans médiation humaine. Le Prophète n'y est pour rien. Il l'a uniquement écrite et transmise. C'est la pure parole de Dieu. Tandis que pour nous [les chrétiens], Dieu entre en communion avec nous, il nous fait coopérer, il crée ce sujet et c'est dans ce sujet que croît et se développe sa parole. Cette part humaine est essentielle, et nous donne également la possibilité de voir que les paroles individuelles ne deviennent réellement Parole de Dieu que dans l'unité de toute l'Écriture dans le sujet vivant du Peuple de Dieu. Le premier élément est donc le don de Dieu ; le second est la participation dans la foi du peuple en pèlerinage [se trouvant sur terre], la communion dans la Sainte Église, qui, pour sa part, reçoit le Verbe de Dieu, qui est le Corps du Christ, animé par la Parole vivante, par le Logos divin [le Verbe, c’est-à-dire le christ]. Nous devons approfondir, jour après jour, notre communion avec la Sainte Église et ainsi avec la Parole de Dieu. Il ne s'agit pas de deux choses opposées, de telle sorte que je puisse dire : je préfère l'Église ou je préfère la Parole de Dieu. […] Celui qui vit de la Parole de Dieu ne peut la vivre que parce qu'elle est vivante et vitale dans l'Église vivante » (Benoît XVI, Discours au clergé de Rome, 2 mars 2006).
« Le Christ « ne se limite pas à parler « au nom de Dieu » comme les prophètes, mais c'est Dieu même qui parle dans son Verbe éternel fait chair. Nous touchons ici le point essentiel qui différencie le christianisme des autres religions, dans lesquelles s'est exprimée dès le commencement la recherche de Dieu de la part de l'homme. Dans le christianisme, le point de départ, c'est l'Incarnation du Verbe. Ici, ce n'est plus seulement l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui vient en personne parler de lui-même à l'homme et lui montrer la voie qui lui permettra de l'atteindre. C'est ce que proclame le prologue de l'Évangile de Jean : « Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître » (1, 18). Le Verbe incarné est donc l'accomplissement de l'aspiration présente dans toutes les religions de l'humanité : cet accomplissement est l'œuvre de Dieu et il dépasse toute attente humaine. C'est un mystère de grâce » (Jean-Paul II, lettre apostolique À l'approche du troisième millénaire , 10 novembre 1994, n° 6). -
Opus Dei : sa place dans l'Église
L’Opus Dei, fondé en 1928 par saint Josémaria Escriva (1902-1975), a été érigé en 1982 en prélature personnelle. Le qualificatif « personnel » distingue ce type de prélature des circonscriptions administratives de l’Église à base territoriale, ce qui est le cas le plus fréquent, notamment avec les diocèses. Mais « personnel » ne veut pas dire « du pape ». Comme toutes les autres circonscriptions administratives ecclésiastiques, la prélature personnelle relève du saint-siège par le biais de la Congrégation pour les évêques, qui en nomme le prélat.
La prélature personnelle relève du droit commun de l’Église, selon les canons 294-297 du code de droit canonique. Elle est assimilée en droit à un diocèse, c’est-à-dire qu’en règle générale les normes qui régissent les diocèses lui sont applicables. Elle peut posséder, en effet, comme dans le cas de l’Opus Dei, un prélat, la gouvernant avec un pouvoir quasi-épiscopal (ou épiscopal, s’il est évêque), un presbyterium propre, c’est-à-dire un ensemble de prêtres adonnés au service des tâches propres de la prélature, et un peuple de fidèles, pouvant, là aussi comme dans l’Opus Dei, y être pleinement incorporés. La prélature personnelle se présente alors comme « une petite partie de l’Église » qui, comme toutes les autres « parties », les Églises particulières ou diocèses notamment, est au service de la mission de l’Église universelle d’évangéliser le monde entier.
La mission de l’Opus Dei est donc une façon de vivre la mission générale et universelle de l’Église. Elle s’exerce au service de l’Église universelle et des Églises particulières, c’est-à-dire essentiellement des diocèses dont les fidèles laïcs de l’Opus Dei continuent de faire partie comme avant d’entrer dans l’Opus Dei. Pour ces fidèles laïcs, le lieu normal de pratique de leur foi est la paroisse, le diocèse auquel ils appartiennent en raison de leur domicile. On pourrait dire que l’apport de l’Opus Dei à chaque diocèse est « une offre de services pastoraux ». Concrètement, du fait que l’Opus Dei forme des chrétiens à assumer pleinement leurs responsabilités dans l’Église et dans le monde, en restant à leur place, leur effort de sainteté personnelle et leur apostolat profitent au diocèse ou à la paroisse d’appartenance. Cette double action (sainteté et apostolat) s’inscrit naturellement dans le cadre des préoccupations pastorales de l’évêque diocésain.
(voir D. Le Tourneau, L’Opus Dei, coll. « Que sais-je ? ») -
Opus Dei : les membres
N’importe quel laïc catholique, c’est-à-dire quelqu’un qui n’a pas reçu le sacrement de l’ordre et qui n’a pas pris d’engagements dans une institution religieuse, peut demander son admission dans l’Opus Dei. Il doit agir avec droiture d’intention, être mû par une vocation divine, c’est-à-dire un appel intime et personnel de Dieu à mettre toute sa vie à son service, selon l’esprit de l'Opus Dei, en tirant parti de ses circonstances dans le monde. Cet appel est unique et le même pour tous : mariés et célibataires, de quelque couche sociale, race ou profession qu’il soit.
L'unicité de la vocation se traduit en ce que tous les membres de la Prélature acquièrent les mêmes engagements ascétiques, apostoliques et de formation doctrinale. C’est, en outre, une vocation qui engage toutes les facettes de la vie : se donner à Dieu dans l’Opus Dei n’amène pas à « sélectionner des activités, ne suppose pas d’employer une partie plus ou moins importante de notre temps à réaliser de bonnes œuvres, en en délaissant d’autres. L’Opus Dei se greffe sur toute notre vie » (saint Josémaria Lettre, 25 janvier 1961).
L’incorporation à la Prélature de l’Opus Dei se fait par une déclaration formelle de nature contractuelle qui donne naissance à un lien stable entre la Prélature et le membre laïc qui désire librement s'y incorporer. Pour le passer, il faut avoir atteint les dix-huit ans. Tant que l’intéressé n’est pas pleinement incorporé à l’Opus Dei, incorporation qui n’intervient au plus tôt qu’au bout de six ans et demi, il renouvelle son engagement chaque année.
Les prêtres de la Prélature sont issus de ses rangs laïcs. Ces prêtres sont ordonnés pour le service pastoral de la Prélature.
Les prêtres déjà incardinés dans d'autres diocèses ne peuvent pas faire partie du clergé de la Prélature : le droit de la Prélature ne le permet pas. Ils peuvent, en revanche, adhérer à la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, dont la finalité est la sanctification sacerdotale selon l’esprit et la pratique ascétique de l’Opus Dei. -
Quelle langue Jésus parlait-il ?
Au Ier siècle dans le pays où Jésus vivait, on sait que quatre langues étaient utilisées : l’araméen, l’hébreu, le grec et le latin.
 photo O. de G.
photo O. de G.
Des quatre, la langue officielle et, en même temps, la moins employée, était le latin. Elle était utilisée presque exclusivement par les fonctionnaires romains entre eux et quelques personnes cultivées la connaissaient. Il ne paraît pas probable que Jésus ait étudié le latin ni qu’il l’ait employé dans sa conversation ordinaire ou dans sa prédication.
En ce qui concerne le grec, il ne serait pas surprenant que Jésus s’en soit servi parfois, car nombre de paysans et d’artisans de Galilée connaissaient cette langue, ou du moins les rudiments nécessaires à une activité commerciale simple ou pour communiquer avec les habitants des villes, qui étaient an majorité de culture hellénique. Le grec était également utilisé en Judée : on calcule que de huit à quinze pour cent des habitants de Jérusalem parlaient le grec. Malgré tout, nous ne savons si Jésus a utilisé un jour le grec, et il n’est pas possible de le déduire avec certitude des textes, même si nous ne pouvons pas écarter cette éventualité. Il est probable, par exemple, que Jésus a parlé à Pilate dans cette langue.
En revanche, les allusions répétées des évangiles à la prédication de Jésus dans les synagogues et des conversations avec les pharisiens sur des textes de l’Écriture rendent plus que vraisemblable qu’il connaissait et utilisait l’hébreu dans certaines circonstances.
Néanmoins, même si Jésus connaissait et utilisait parfois l’hébreu, il semble que, pour la conversation ordinaire et la prédication, il parlait d’ordinaire en araméen, qui était la langue normale d’usage courant entre les Juifs de Galilée. De fait, le texte grec des Évangiles laisse parfois des mots ou des phrases en araméen sur les lèvres de Jésus : talitha qum (Marc 5, 41), effetha (Marc 7, 34), géhenne (Marc 9, 43), abba (Marc 14, 34), Eloï, Eloï, lema sabacthani ? (Marc 15, 34), ou de ses interlocuteurs : rabbuni (Marc 10, 51).
Les études sur l’arrière-fond linguistique des Évangiles font ressortir que les mots qui y sont recueillis ont été prononcés originairement dans une langue sémitique : l’hébreu ou, plus probablement, l’araméen. Cela se remarque aux tournures du grec utilisé dans les Évangiles,qui manifestent une matrice syntactique araméenne. Mais cela peut se déduire aussi du fait que des mots mis par les Évangiles sans la bouche de Jésus acquièrent une force particulière quand ils sont traduits en araméen, et que certains mots sont utilisés avec une charge sémitique distincte de celle qu’ils ont habituellement en grec, qui dérive d’un usage sémitisant. Il arrive même qu’en traduisant les Évangiles dans une langue sémitique on découvre des jeux de mots qui restent cachés dans l’original grec.
Francisco Varo, doyen de la Faculté de théologie de l’Université de Navarre
Disponible sur le site www.opusdei.es
Traduit par mes soins -
Opus Dei : les moyens
On peut s’interroger sur les moyens de l’Opus Dei. J’ai dit dans un message précédent que la finalité de la Prélature de l’Opus Dei est d’ordre strictement spirituel. On ne s’étonnera pas dès lors que les moyens soient eux aussi spirituels.
L’actuel prélat de l’Opus Dei, Monseigneur Xavier Echevarria, a témoigné au cours du procès en béatification du fondateur de l’Opus Dei que ce dernier lui avait affirmé : « L’unique arme que nous avons eue, et que nous aurons toujours, ne l’oublie pas, c’est la prière. Il n’y en a pas d’autre. Si tu ne pries pas, tout s’effondre » : il n’est plus possible de devenir saint et d’aider les hommes à le devenir.
Dans l’esprit de l’Opus Dei, la vie consiste à travailler et à prier et, à l'inverse, à prier et à travailler. Car le moment vient où « il est impossible de distinguer où termine la prière et où commence le travail », disait le fondateur. Sans le travail et l'accomplissement des devoirs personnels, il ne peut y avoir, pour un chrétien courant, de vie de prière, de vie contemplative... Sans vie contemplative, prétendre travailler pour le Christ n’aurait guère de sens. Ce serait comme coudre avec une aiguille sans fil… (voir D. Le Tourneau, L’Opus Dei, coll. « Que sais-je ? »).
Les seuls moyens financiers dont la Prélature dispose ont trait au culte et à « l’honnête subsistance » du clergé de la prélature dont le prélat a la charge. En France, un statut d’association du même type que celui qui a été accordé aux diocèses français, « l’Association de la prélature personnelle dite Prélature de la Sainte-Croix et Opus Dei », permet d’assumer les frais du culte catholique (siège de la curie du vicaire, églises éventuelles, séminaire éventuel, vie et formation permanente des prêtres, cérémonies, etc.).
Comme pour n’importe quel catholique courant, les biens de l’entreprise ou de la société dans laquelle il travaille n’appartiennent pas à l’institution religieuse dont il relève, que ce soit le diocèse, le diocèse aux armées, une prélature, etc. -
L'Opus Dei : les objectifs
Selon son fondateur, saint Josémaria Escriva, « l’Opus Dei propose d’encourager des gens qui appartiennent à toutes les classes de la société à vivre la plénitude de la vie chrétienne au sein du monde » (Entretiens avec Monseigneur Escriva, n°24). Comme je l’ai écrit dans mon « Que sais-je ? » consacré à L’Opus Dei, « la mission de l’Opus Dei consiste à collaborer à la mission d’évangélisation de l’Église, en promouvant parmi des chrétiens de toute condition une vie pleinement cohérente avec la foi, dans les circonstances ordinaires de l’existence, en particulier par la sanctification du travail. L’Opus Dei se propose donc d’aider à transformer le travail et toute tâche en prière, moyen et occasion d’apostolat, de parler de Dieu aux autres, et à l’accomplir avec la plus grande perfection possible ». Le fondateur a expliqué à un journaliste que l’activité principale de l’Opus Dei consiste à « donner à ses membres, et aux personnes qui le désirent, les moyens spirituels nécessaires pour vivre dans le monde en bons chrétiens » (Entretiens avec Monseigneur Escriva, n° 27) ».
L’objectif est donc d’ordre spirituel et se borne pleinement à cet aspect.
Autrement dit, l’action de l’Opus Dei consiste à rappeler aux chrétiens qu’ils sont appelés à se sanctifier et témoigner de leur foi dans leur vie courante de travail, de famille, de loisirs, de relations sociales, etc., et à leur fournir les moyens spirituels et la formation doctrinale leur permettant d’y arriver.
Le reste, tout le reste, c’est-à-dire les options familiales, professionnelles, sociales, politiques, éthiques, culturelles ou autres, sont du ressort de la liberté de chacun, sous son entière responsabilité. Il n’appartient pas à la Prélature de l’Opus Dei ni à ses dirigeants de donner quelque consigne que ce soit dans ce domaine, en dehors du fait de rappeler l’enseignement de l’Église.
Attribuer à l’Opus Dei les activités de citoyens courants qui en font partie n’a pas plus de sens que de les attribuer au diocèse auquel ils appartiennent aussi ou, de façon plus générale, à l’Église catholique. -
Sainte Catherine de Sienne

L’Église célèbre aujourd’hui sainte Catherine de Sienne, une des nombreuses figures féminines qu’elle donne en exemple aux fidèles.
Catherine est née à Sienne, en Italie, le 25 mars 1347. Elle était le vingt troisième enfant du teinturier Jacopo Benincasa et de Lapa Piagenti. À l’âge de six ans elle reçoit sa première vision. Elle mène alors une vie profondément religieuse. Au lieu de mariage ou une vie monastique, elle a opté de rester avec ses parents, dans une sorte de cellule. À l’âge de seize ans, elle devient tertiaire dominicaine, une « mantellata » somme toute, nom donné à Sienne aux tertiaires en raison de leur manteau noir.
Sainte Catherine mène de concert une vie de contemplation et le soin de son prochain, s’occupant des malades de l’hôpital Della Scala et de la léproserie Saint-Lazare. Autour d’elle s’est constitué rapidement tout un cercle de personnes attirées par son ascendant spirituel et sa bonne humeur, groupe qu’elle appelle sa belle compagnie. Elle obtient des conversions retentissantes.
Ses visions font connaître rapidement Catherine dans toute l’Italie. En 1374 elle a pris pour confesseur Raymond de Capoue (environ 1330-1398), qui devient maître-général de l’Ordre dominicain en 1380. Stimulée par son confesseur, elle s’occupe de plus en plus avec le politique des villes et avec la situation de l’Église, œuvrant pour la réconciliation des familles et des villes ennemies. Le 1er avril 1375, Catherine reçoit les stigmates de la Passion du Christ.
Lors d'une apparition, le Christ lui demande d’intervenir auprès du pape d’Avignon pour le convaincre de revenir à Rome. Reçue par lui en 1376, elle l'entretient de la situation de l'Église, lui reprochant son indécision, et le presse de revenir à Rome. Elle revient à la charge par écrit après son départ d’Avignon. L'entourage pontifical, attaché au luxe et à la douceur avignonnaise fait pression contre elle. Mais elle parvient à décider Grégoire XI qui, le 13 septembre 1376, regagne Rome, où il meurt le 27 mars 1378. Pour Catherine, le pape est « le doux Christ sur la terre », en tant que vicaire du Christ à la tête de l’Église. Catherine est aussi habitée par la mystique de la croisade, qu’elle prêche au pape.
Urbain VI succède à Grégoire XI mais, le 20 septembre 1378, c’est le schisme, un pape ayant été également élu à Avignon. Le 29 avril 1380, sainte Catherine meurt à Rome dans sa petite maison de la via del Papa, non loin de l’église de Santa Maria sopra Minerva, où elle est enterrée.
Catherine, qui ne savait pas écrire, a dicté son chef-d’œuvre, le Dialogue, ou « Livre de la divine doctrine », commencé en 1378. Nous conservons plus de 380 lettres adressés à des princes, aux citoyens et aux clercs, aux prêtres et moniales, mais aussi aux cardinaux et aux papes. Il y a aussi une collection de 26 prières.
Sainte Catherine est canonisée par Pie II en 1461. En 1866 elle est déclarée co-patronne de Rome. Depuis 1939, elle est patronne de l’Italie, avec saint François d’Assise. En 1970, elle a reçu du pape Paul VI le titre du Docteur de l’Église, étant la seconde femme (après Thérèse d'Avila) à le devenir et la seule laïque. Jean Paul II a proclamé en 1999 Catherine co-patronne de l'Europe, en même temps que sainte Brigitte de Suède et la bienheureuse Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein).