Le rosaire, du latin rosarium, « couronne », est une pratique de piété principalement diffusée par les dominicains de sorte qu’une tradition en attribue l’origine à leur fondateur, saint Dominique (v. 1170-1221), qui l’aurait reçue directement de la Vierge Marie. Elle consiste à réciter cent cinquante « Je vous salue Marie », répartis par groupes de cinquante, en méditant les « mystères » de la vie de notre Seigneur et de sa Mère, mystères « joyeux », « douloureux » et « glorieux ». C’est le « psautier de la Vierge », le « Bréviaire de l’Évangile », ou encore un « abrégé de tout l’Évangile » (Paul VI, encyclique Marialis cultus) et l’expression du culte et de la dévotion envers Marie. Le pape saint Pie V en a fixé la forme traditionnellement 1569. chaque groupe de cinq mystères est appelé « chapelet ». En 2002, le pape Jean-Paul II y a ajouté cinq mystères « lumineux », recouvrant la vie publique de Jésus.
Commençons par dire d’abord un mot de l’efficacité de la récitation du rosaire. « L’histoire de l’Église atteste l’efficacité de cette prière :elle nous rappelle la défaite des troupes turques dans un combat naval près des îles Échinades, et les victoires éclatantes remportées au siècle dernier sur le même peuple à Temesvar, en Hongrie, et à l’île de Corfou. Grégoire XIII voulut perpétuer le souvenir du premier de ces triomphes par l’institution d’une fête en l’honneur de Marie victorieuse. Plus tard, notre prédécesseur, Clément XI, appela cette solennité fête du Rosaire et décréta qu’elle serait célébrée chaque année dans l’Église universelle. Cette milice priante, étant « enrôlée sous l’étendard de Marie », en acquiert une nouvelle force et un nouvel honneur. C’est le but que vise spécialement, dans la prière du Rosaire, la répétition fréquente de la salutation angélique après la récitation de l’oraison dominicale » (Léon XIII, encyclique Augustissimæ, 12 septembre 1897).
Le pape Jean-Paul II a consacré une lettre apostolique au Rosaire de la Vierge Marie.
Le mois d’octobre étant donc consacré à la dévotion du rosaire, je me propose de donner un bref commentaire de chacun des vingt « mystères » et de parler aussi de la fête de Notre Dame du Rosaire, qui a lieu le 7 octobre.
Dominique Le Tourneau - Page 195
-
Le rosaire
-
Voyage en Italie (suite 5)
13 mars. Nous avons passé la journée dans les ruines de la vieille Rome, le matin au Forum, l’après-midi au Palatin et au Colisée. Que de changements : le Forum, découvert de l’Arc de Septime Sévère à l’Arc de Titus, on suit la Voie sacrée, bordée de temples et de ruines de toute sorte, et personne ne passe plus là où nous avons vu voitures, bêtes et gens circuler sur une route poussiéreuse au milieu de l’herbe. On ne peut se figurer l’entassement de monuments, de ruines, de débris de toute sorte, et, malgré les souvenirs classiques, on a peine à se retrouver au milieu de toutes ces constructions ruinées.
Au Palatin, on a presque tout mis au jour : Palais de Caracalla, des Flaviens, de Septime Sévère, de Livie, où l’on voit des peintures plus belles que celles de Pompéi, dont le fini, le modelé étonnent.
Au milieu du Palais de Septime Sévère se trouve un cirque de plus de 150 mètres de long, entouré de portiques ; la loge impériale existe encore avec sa voûte ornée de caissons ; c’est fabuleux de proportions, et tout a été découvert depuis 1866.
Aussi suis-je bien heureux d’être revenu à Rome, qui, gâtée dans certaines parties, est encore plus intéressante dans ses parties anciennes.
Le Colisée a été débarrassé de son ridicule Chemin de Croix ; il produit toujours le même effet de construction colossale.

14 mars. Je suis allé à Saint-Paul-hors-les-murs et ai erré dans la Ville, pendant que Blanche était à Tivoli. Je lui passe la parole : « La visite de Tivoli est maintenant presque toujours précédée par celle de la Villa d’Hadrien que l’on a dégagée il y a trente ans, et qui est à quatre kilomètres avant Tivoli.
Hadrien avait réuni là théâtres, thermes, naumachies, stades, école de philosophes, habitation, temple égyptien, etc. Ce sont des restes très importants au milieu d’un parc d’oliviers et de grands cyprès. La visite en est extrêmement intéressante, bien que tous les marbres aient été enlevés et mis dans les musées.
À Tivoli, je suis allée sous la pluie aux Cascades et au Temple de Vesta. C’est un paysage charmant, et j’en suis revenue enchantée ».
15 mars. Nous avons, par un temps superbe, passé une journée charmante, le matin à la Villa Borghèse, devenue la Villa Umberto. Les ombrages, les perspectives, les pièces d’eau sont des plus heureux.

Rachetée par la Ville après la déconfiture des Borghèse, elle est devenue le Bois de Boulogne d’ici, en conservant tous ces beaux restes des demeures de neveux des Papes.
De là au Pincio, l’ancienne promenade romaine, où j’avais rêvé quand j‚avais 23 ans et attrapé les fièvres pour m’être attardé dans mes rêves.
Après avoir descendu l’escalier de la Trinité des Monts pour arriver à la Place d’Espagne, et avoir déjeuné dans un excellent restaurant italien, nous sommes allés à Sainte-Marie-Majeure et à San-Lorenzo-hors-les-murs, pour revenir au Quirinal et à la Fontaine Trevi. Quel ravissement en face de ces œuvres vraiment remarquables : Sainte-Marie-Majeure par ses belles proportions et ses mosaïques, San-Lorenzo par ses superbes mosaïques byzantines, les seules de Rome, ses ambons ornés de dessins en mosaïques, ses colonnes de marbre blanc, couronnées de chapiteaux corinthiens, intacts, et par deux chapiteaux tout à fait uniques, représentant une armure romaine avec bouclier, et des Victoires aux angles.
Quel ravissement en face de ces œuvres vraiment remarquables : Sainte-Marie-Majeure par ses belles proportions et ses mosaïques, San-Lorenzo par ses superbes mosaïques byzantines, les seules de Rome, ses ambons ornés de dessins en mosaïques, ses colonnes de marbre blanc, couronnées de chapiteaux corinthiens, intacts, et par deux chapiteaux tout à fait uniques, représentant une armure romaine avec bouclier, et des Victoires aux angles.
Cette basilique a été restaurée par Pie IX qui y a son tombeau, fort simple d’ailleurs, mais dans une chapelle décorée de mosaïques superbes.
En rentrant, nous avons admiré la superbe fontaine Trevi, que l’on ne peut se lasser de voir, un des plus beaux chefs d’œuvre de l’architecture.
16 mars. Notre journée s’est passée à visiter Saint-Pierre, les musées du Vatican, Saint-Paul-hors-les-murs et les ruines sur le chemin. Le tombeau du Pape Léon XIII à Saint-Pierre est des plus simples, sarcophage en marbre blanc dans une niche au-dessus d'une porte, avec dessus un coussin sur lequel est posée la tiare. Ni figure, ni symbole.
Les Chambres de Raphaël sont toujours aussi impressionnantes par leur puissante et magnifique décoration. On les a restaurées et elles sont en bon état ; il n’en est pas de même des Loges, dont les superbes décorations, genre Pompéi, ont presque partout disparu. On a restauré les scènes de l’Ancien Testament, qui sont dans les voûtes, mais d’une coloration trop vive.
La Chapelle Sixtine n‚a pas changé non plus, quoique les fresques m’aient paru un peu noircies. La Chapelle de Nicolas V avec les fresques de Fra Angelico est un bijou.
Les musées d’art antique sont les plus riches que je connaisse, il y a là réunis des chefs d’œuvre incomparables, et on ne peut se lasser d’admirer les quatre merveilles du Belvédère.
En avant de Saint-Paul-hors-les-murs, on achève un superbe portique formant atrium orné de magnifiques colonnes de granit, avec bases et chapitaux corinthiens en marbre blanc ; la façade au-dessus du portique est décorée de mosaïques représentant le Père éternel, les Quatre docteurs, l’Agneau Pascal faisant couler les sources où les brebis viennent puiser les bonheurs célestes et peut-être terrestres.
On pense restaurer le cloître : il m’a ravi, plus que celui de Monreale, qui est dans le même style.
(à suivre…) -
Voyage en Italie (suite 4)
7 mars, temps couvert. Nous sommes allés au Musée [de Naples], dont nous avons revu les chefs d’œuvre, et avons parcouru la vieille ville, où j’ai retrouvé quelques marchands de cuisine en plein air, à la Porte Capuana, mais bien moins qu’autrefois.
Ensuite, visite de la Cathédrale, que je ne me rappelais pas. La nouvelle façade sera bien, lorsque les deux flèches seront achevées.
Que ce pays est donc beau !
9 mars. Le temps couvert nous a fait rester à Naples. Nous sommes allés au Campo Santo, fort curieux par toutes ces chapelles de confréries où l’on dépose les corps momifiés dans des caves, comme aux catacombes à Rome. Quelques-unes sont comme de petites églises ; il y en a aussi comme les nôtres et des monuments plus ou moins baroques.
Le jour, nous sommes allés dans les parties neuves de la ville, avec rues à angles droits, et à San Martino pour redescendre à Chiaja par les nouvelles voies en corniche. Nous avons eu la chance de rencontrer un quatuor ambulant, violon, violoncelle, flûte et clarinette qui ne jouait vraiment pas mal. Il y a eu un air populaire, repris en chœur par les auditeurs.
 Pompéi, 10 mars. J’ai eu la joie de retrouver tout seul la maison que j’avais relevée en 1866. Je l’ai parcourue avec amour, car je retrouvais mon enfant, et ai admiré tout ce que j’avais dessiné il y a quarante ans. Mais aussi, j’ai éprouvé une vraie peine en voyant dans quel état de vétusté et de délabrement étaient toutes les peintures que je trouvais si vives et si bien conservées, lorsqu’on les découvrait devant moi. Dans ce qui était le jardin, il y a encore de ces grandes jarres, dans lesquelles j’avais recueilli du lait solidifié. Cette maison doit avoir été reconnue comme ayant un intérêt spécial, car elle a une inscription spéciale et est mentionnée au guide.
Pompéi, 10 mars. J’ai eu la joie de retrouver tout seul la maison que j’avais relevée en 1866. Je l’ai parcourue avec amour, car je retrouvais mon enfant, et ai admiré tout ce que j’avais dessiné il y a quarante ans. Mais aussi, j’ai éprouvé une vraie peine en voyant dans quel état de vétusté et de délabrement étaient toutes les peintures que je trouvais si vives et si bien conservées, lorsqu’on les découvrait devant moi. Dans ce qui était le jardin, il y a encore de ces grandes jarres, dans lesquelles j’avais recueilli du lait solidifié. Cette maison doit avoir été reconnue comme ayant un intérêt spécial, car elle a une inscription spéciale et est mentionnée au guide.
Nous avons eu un grand bonheur en revoyant cette ville si intéressante et curieuse. Mais le temps a fait son œuvre et une grande partie des peintures est altérée au point de ne plus être reconnaissable. Telles celles de la Maison de Faune et du Poète tragique.
et du Poète tragique. 
Quel changement aussi dans ce petit coin : on y arrive en train ou tram électrique ; l’Hôtel Dieu est éclairé à l’électricité, et nous y avons bu d’excellent Lacryma-Christi.
Pompéi, 11 mars. Pendant que votre Maman montait au Vésuve, je suis allé flâner dans les ruines, évoquant mes souvenirs et ceux de ma jeunesse. J’étais d’autant plus heureux que j’étais seul, et que j’ai pu aller et venir sans rencontrer de forestieri.

Dans la journée, après 3 heures, votre Mère étant revenue, nous avons visité la Villa Diomède, la Voie des Tombeaux, la Maison du Faune et le Musée, où sont les moulages palpitants encore des angoisses de la mort.
Votre Mère dit : « Le temps était clair le matin ; j’en ai profité pour monter au Vésuve, évitant ainsi la caravane Cook, et y allant d’ici seule, avec une voiture, un cheval et un guide. Quelle déception en haut : des nuages partout, et après m’être fait haler sur le cône de cendres, il m’a été dit : voilà le cratère, vous le voyez fumer ; il n’est pas prudent d’aller plus loin, et il n’y a qu’à redescendre. En bas du cône, nous avons obliqué pour nous approcher d’une coulée de lave incandescente.
Le temps s’est éclairci lorsque j’étais dans la plaine. Il semble que cette époque de l’année n’est pas favorable aux ascensions. La prudence n’était pas exagérée ; il y a eu deux jets de pierres incandescentes comme nous commencions à descendre, et l’un des voyageurs a été blessé à l’endroit où nous devions aller.
La descente en déambulant dans la cendre était amusante, et les guides ne comprenaient pas que je préfère gagner la voiture à pied plutôt qu’endurer les secousses du cheval ».
Rome, 12 mars. En face de la Poste, installée dans le couvent où étaient en 1866 le mess des officiers et le Génie, j’ai retrouvé la maison où j’avais habité chez le commandant Maurice, maintenant Maison de Banque. Puis nous sommes allés à la Place du Peuple, qui n’a pas changé, avec ses fontaines, ses églises, et l’entrée du Pincio, puis au Palais Borghèse où il y a maintenant un marchand d’antiquités.
Par la via Repetta, nous sommes allés au Tibre, qui est maintenant bordé de hauts quais avec des ponts en fer, ce qui le fait ressembler à un canal d’eau jaune et sale ; puis nous sommes revenus à la Place Navone, où il n’y a plus une seule boutique ambulante, ni un seul mendiant. Nous sommes passés devant le Panthéon, qui est complètement dégagé et entouré de grilles pour protéger les restes de murs que l’on a trouvés derrière.
où il n’y a plus une seule boutique ambulante, ni un seul mendiant. Nous sommes passés devant le Panthéon, qui est complètement dégagé et entouré de grilles pour protéger les restes de murs que l’on a trouvés derrière.
(à suivre…) -
Voyage en Italie (fin)
16 mars. Nous avons vu Saint-Jean-de-Latran
 et son musée, où il y a tant de choses superbes, la Voie Appienne, et, après déjeuner dans une osteria ayant vue sur la campagne romaine, nous sommes revenus par les Thermes de Caracalla.
et son musée, où il y a tant de choses superbes, la Voie Appienne, et, après déjeuner dans une osteria ayant vue sur la campagne romaine, nous sommes revenus par les Thermes de Caracalla.
La campagne de Rome n’existe plus : partout la culture a remplacé les monticules stériles d’autrefois, et tout ce désert est maintenant habité. C’est certainement bien préférable au point de vue humain, mais l’artiste n’en déplore pas moins le charme qu’il avait éprouvé en voyant, de la Porte de Saint-Jean, la campagne au lever du soleil.
17 mars. Prenant une voie qui menait à la Via Appia, nous avons recherché le Tombeau de Cecilius Metelle ; mais après avoir visité les sépultures des Scipions, nous nous sommes attardés pour déjeuner en plein air dans une osteria, avec, dans le fond, les montagnes de la Sabine, dont les cimes sont encore couvertes de neige.
Puis nous sommes revenus admirer les ruines imposantes des Thermes de Caracalla, que l’on a bien changées par les consolidations qu‚on y a faites, mais dont on a aussi déblayé des parties que j’avais vues encombrées de débris de toute sorte.
que l’on a bien changées par les consolidations qu‚on y a faites, mais dont on a aussi déblayé des parties que j’avais vues encombrées de débris de toute sorte.
[Nous sommes] rentrés par le Forum de Trajan et l’église du Gesù.
Rome, 19 mars. Notre journée du dimanche s’est passée à visiter quelques églises, après avoir assisté à la messe au Gesù, toujours aussi mondain et aussi fréquenté ; nous avons entendu des chants grégoriens.

À 11 heures un quart, nous étions au Palais Farnèse à admirer la belle galerie peinte par les Carrache, qui est restée superbe, fraîche de coloris, et si harmonieuse de composition. Ce beau palais appartient à la France, qui y loge son ambassadeur.
Puis nous sommes allés au Trastevere, qui est bien changé : sur les hauteurs à travers les jardins de Saint-Onofrio, de la Villa Corsini et de Saint-Pierre-in-Montorio, jusqu’à la fontaine de l’Aqua Paula, on a créé un superbe jardin, avec de beaux arbres, palmiers et conifères, d’où l’on a la plus belle vue sur Rome, le Vatican, Saint-Pierre et la campagne.
Aujourd’hui, j’ai passé la journée à errer dans la ville, à revoir bien des coins où j’étais passé étant jeune, pendant que Blanche était à Albano.
C’est la fête de Saint Joseph ; aussi beaucoup de monde dans les églises, presque toutes les boutiques fermées, et toutes les trattoria populaires ornées de branches vertes, avec tentures aux couleurs pontificales et italiennes, et un tableau représentant Saint Joseph tenant l’Enfant dans ses bras. Et l’on fabrique des montagnes de beignets, que le peuple mange sur place ou emporte chez lui pour festoyer. C’est tout à fait local : c’est un vrai jour de fête : on se promène et on festoie.
Rome est transformée et beaucoup de monuments sont mis en valeur, et bien des quartiers sont assainis ; il n’y a plus que des coins où l’on retrouve les vicolos d’autrefois. L’artiste n’y trouve plus ce pittoresque qui le charmait : ainsi, la Place Navone a maintenant des trottoirs en bitume, des grilles autour des fontaines, des bancs en marbre et l’éclairage électrique.
Où sont les étalages de marchands de fruits, légumes, fleurs, les gens mangeant leur romaine, assis sur les vasques des fontaines, les femmes vendant leurs vieilles épingles en cuivre ; c’est maintenant une place qui n’a plus d’attrait que ses magnifiques fontaines. Ces beautés artistiques feront toujours de Rome une ville sans rivale.
Blanche prend la parole : Je suis enchantée de ma promenade à Albano et Nemi, pour laquelle le temps m’a favorisée. Je suis allée à pied d’Albano à Nemi par une route superbe, avec de très beaux points de vue sur la campagne et au milieu d’oliviers magnifiques ; j’ai trouvé le lac Nemi délicieux avec ses eaux bleu clair et les deux petites villes de Genzano et Nemi perchées sur les deux rives opposées.
et Nemi perchées sur les deux rives opposées.
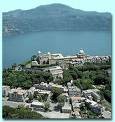
J’ai poussé à pied jusqu’à Castelgandolfo, où j’ai repris le chemin de fer : la route domine le lac d’Albano et a des points de vue charmants.
Gênes, 21 mars. Nous sommes arrivés hier soir après onze heures de chemin de fer peu intéressant sur une grande partie. Le paysage autour de Pise et Massa est assez beau, avec des montagnes aux silhouettes découpées, en partie encore couvertes de neige ; on voit en certains endroits les carrières de marbre.
Nous sommes allés au Campo Santo, qui a étonné votre Mère par sa grandeur. Les monuments sont pour la plupart bien médiocres et d’une modernité bien déplorable. On souhaiterait plus de sobriété et dans la forme et dans l’exécution.
Ernest Le Tourneau -
Le péché originel (1)
1. Son existence.
Il est pour le moins étrange que l’on parle si peu du péché originel, alors qu’il s’agit d’une réalité essentielle qui apporte une explication aux problèmes du monde.

Voyons les faits. Après avoir créé Adam et Ève, nos premiers parents, Dieu les plaça dans le jardin d’Éden, le paradis, en disant : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; mais quant à l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu seras condamné à mourir » (Genèse 2, 16-17). Las, voilà que, dédaignant tout ce dont ils disposent, Adam et Ève se laissent séduire par cet arbre et par le diable qui présente à Ève Dieu comme un obstacle à sa liberté. Il commence par poser une question apparemment innocente, mais en réalité très pernicieuse : « Est-ce vrai que Dieu a dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » (Genèse 3, 1). L’interdit ne porte que sur les fruits d’un seul arbre. Ève tombe dans le piège et commence à dialoguer avec le démon. C’est son erreur fatale. « Ne dialogue pas avec la tentation. Laisse-moi te le redire : aie le courage de fuir, aie la force de ne pas jouer avec ta faiblesse, en te demandant jusqu’où tu pourrais tenir. Tranche, sans concession ! (saint Josémaria, Sillon, n° 137).
Elle dit au serpent, forme sous laquelle le diable se présente à elle : « Des fruits des arbres du jardin, nous en mangeons. Mais les fruits de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez pas et vous n’y toucherez pas, sinon vous mourriez » (Genèse 3, 2-3). Elle rétabli la vérité, certes. Mais le « serpent était le plus avisé de tous les animaux des champs » (Genèse 3, 1). Il sait comment embobiner son interlocutrice :
« Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal » (Genèse 3, 4-5).
Alors, « la femme vit que beau à voir, l’arbre était bon à manger, et désirable pour acquérir l’intelligence ; elle prit de ses fruits et en mangea ; elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea » lui aussi, sans se soucier davantage des instructions divines (Genèse 3, 6).
Les conséquences sont immédiates : « Leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils connurent qu’ils étaient nus ; et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures » (Genèse3, 7). La nudité, qui ne leur posait aucun problème tant que les passions étaient soumises à la raison, devient quelque chose de honteux et réclame la pudeur, une vertu qui « désigne le refus de dévoiler ce qui doit rester caché » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2521).
L’homme se cache quand Dieu vient à sa recherche (voir Genèse 3, 9-10) : il a perdu confiance en la bonté paternelle de Dieu et, faisant un mauvais usage de sa liberté, a désobéi au commandement qu’il lui avait donné. C’est le premier péché, et c’est en cela que consiste aussi tout péché.
« Dans ce péché, l’homme s’est préféré lui-même à Dieu, et par là-même il a méprisé Dieu : il a fait le choix de soi-même contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et dès lors contre son propre bien » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 398).
Ce péché n’est pas un défaut de croissance, une faiblesse psychologique, une simple erreur ou la conséquence d’une structure sociale inadéquate. Il faut le voir à la lumière de la Révélation divine : « C’est seulement dans la connaissance du dessein de Dieu sur l’homme que l’on comprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu’elles puissent L’aimer et s’aimer mutuellement » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 388).
« L’homme et la femme sont responsables de la faute. Mais derrière leur choix, il y a une voix séductrice, opposée à Dieu (voir Genèse 3, 5), un accusateur de l’homme (voir Job 1, 11 ; 2, 5-7) qui, par envie, le fait chuter dans la mort (voir Sagesse 2, 24). L’Écriture et la tradition de l’Église voient en cet être un ange déchu, appelé satan ou diable » (Catéchisme des évêques de France, n° 115).
(à suivre…) -
La prière (5 et fin)
Les obstacles à la prière
Prier n’est pas toujours une entreprise facile, car nous rencontrons divers obstacles qui peuvent nous en écarter, ou bien nous pouvons en détourner le sens. « Dans le combat de la prière, nous avons à faire face, en nous-mêmes et autour de nous, à des conceptions erronées de la prière. Certains y voient une simple opération psychologique, d’autres un effort de concentration pour arriver au vide mental. Telles la codifient dans des attitudes et des paroles rituelles. Dans l’inconscient de beaucoup de chrétiens, prier est une occupation incompatible avec tout ce qu’ils ont à faire : ils n’ont pas le temps. Ceux qui cherchent Dieu par la prière se découragent vite parce qu’ils ignorent que la prière vient aussi de l’Esprit Saint et non pas d’eux seuls » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2726).
Le danger est bien réel de ne prier que par envie ou par nécessité. Écoutons le témoignage d’une mère de famille, mêlée à la vie publique de son pays : « Les jours où je ne ressentais pas le besoin de Dieu, mes actions avaient une inspiration superficielle, matérialiste ; j’oubliais la prière, j’étais trop paresseuse et indifférente. C’est comme si j’avais dit à quelqu’un : « Je t’aime, mais seulement à mes conditions et quand j’en ai envie. Je te contacterai, mais toi, ne m’appelle pas » (J. H. Matlary, Quand raison et foi rencontrent, Paris, 2003, p. 257).
La distraction est un autre obstacle. Notre capacité de concentration est malheureusement très limitée. Mais « une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour Lui, en Lui offrant résolument notre cœur pour qu’Il le purifie. Là se situe le combat, le choix du Maître à servir » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2729). « Jésus, que mes distractions soient des distractions à l'envers : au lieu de me souvenir du monde, lorsque je te parle, que je me souvienne de toi en m'occupant des affaires du monde » (saint Josémaria, Forge, n° 1014).
L’aridité ou la sécheresse peut également se faire sentir. Le cœur ne ressent ni envie de prier ni sentiments particuliers. « C’est le moment de la foi pure qui se tient fidèlement avec Jésus dans l’agonie et au tombeau » (Catéchisme de l’Église catholique, n° 2731). C’est l’heure de la persévérance et de la fidélité aux rendez-vous que nous nous sommes librement fixés avec Dieu. Nous savons qu’il existe. Nous croyons qu’il est présent, qu’il nous voit, qu’il nous entend, même si nous n’en faisons pas l’expérience sensible. « Le grain de blé, s’il meurt, porte beaucoup de fruit » (Jean 12, 24). Mais « si la sécheresse est due au manque de racine, parce que la Parole est tombée sur du roc, le combat relève de la conversion » (Ibid.), du retour filial et contrit vers Dieu, de la protestation de notre amour sincère.
« Dans ta vie de piété, persévère, volontairement et par amour — même si tu te sens sec. Et que t'importe si tu te surprends à compter les minutes ou les jours qui te restent pour achever cette norme de piété ou ce travail, et si tu éprouves le plaisir trouble du mauvais élève qui, dans des circonstances comparables, attend la fin des cours; ou de l'homme condamné à vingt ans de prison, qui attend que les portes de la geôle s'ouvrent devant lui pour retourner à ses erreurs.
Persévère, j'y insiste! Avec une volonté efficace et renouvelée, sans jamais cesser de vouloir effectuer ces exercices de piété et d'en tirer profit » (saint Josémaria, Forge, n° 447). -
Voyage en Italie en 1906
Un de mes cousins, Louis Le Tourneau, a retrouvé de vieux papiers de famille et a pris la peine de transcrire le récit de voyages de mon arrière grand-père, Ernest Le Tourneau (1843-1917). Après le récit d’un voyage à Pompéi et au Vésuve, en 1866, on trouvera ci-dessous un nouveau récit, rédigé sous la forme d’un journal. Il est intéressant de remarquer les différences quarante ans plus tard, d’autant que cette année en marque le centenaire.
VOYAGE de M. et de Mme Ernest LE TOURNEAU en Sicile, à Naples, à Pompéi, au Vésuve et à Rome, du 15 février au 21 mars 1906

15 février, à bord, de Gênes à Naples. Wagon bon et bien chauffé. Dehors, de la neige depuis Dijon, jusqu’à Gênes, avec un beau soleil la faisant briller pour la montée du Cenis ; puis, à la descente, un brouillard froid et gris venant voiler les plaines blanches et rendre le trajet ennuyeux jusqu’à Gênes.

Mercredi [14 février], visite de la ville et du port, par un temps froid et des ondées. Les palais ont un air de noblesse admirable. Nous en avons visité un, le Palais Palavicine, et nous avons été émerveillés du mouvement du port. Quelle différence avec Le Havre !
Les vieilles rues de Gênes, étroites et montantes, sont bien amusantes, surtout à la sortie des fabriques ou autres endroits de réunion, quand le peuple encombre les vicolos.
À 8 heures et demie, embarquement sur le Petoro, qui devait partir à 9 heures. Mais le chargement [ne s’est] terminé qu’à 4 heures du matin. Le bruit des grues, des gens et des caisses ou ballots ne favorisait pas le sommeil. Notre cabine est bonne, le déjeuner a été bon, vite servi, la mer est d’huile, et le soleil, peu à peu, est devenu brillant. Nous sommes assez près de la côte pour ne jamais la perdre de vue ; parfois même, on distingue toutes les maisons.
Il ne fait pas froid au soleil, et votre Père respire le bonheur, bonheur complet, car nous ne rattraperons pas notre retard, et n’arriverons à Naples que vers 3 heures au lieu du lever du jour.
M. Ernest Le Tourneau ajoute : Gênes a bien changé depuis mon premier séjour : larges voies, grandissimes maisons, comme à Paris, mais avec les beaux matériaux du pays et une diversité de styles amusante : romain, byzantin, gothique, moderne et grec. Tout se côtoie et se nuit un peu. Décidément, j’aime mon vieux Gênes.

Notre arrivée à Naples, vendredi 11 heures par un temps superbe, nous a permis de bien jouir de la vue de la baie, en rasant toute la côte depuis Misène.

Dans la journée, par un soleil superbe, nous sommes allés à San Miniato et revenus par le Corso Vittorio Emanuele. Nous sommes allés à Chiaja et avons visité l’aquarium, très intéressant. Mais que Naples a changé, et comme je suis loin de retrouver tout ce que j’avais vu. Ce n’est plus cette ville qui était si curieuse par ses vicolos, ses places populaires, et Santa Lucia avec ses osterias. Tout a disparu, mais c’est encore le pays de la lumière, et de la vie si vivante du midi, qui m’a toujours ravi.

Notre arrivée à Palerme à 7 heures nous a permis de voir l’entrée du port avec un demi soleil, car il y avait quelques nuages ; mais peu à peu le ciel s’est dégagé et nous venons de faire une agréable promenade, à voir des églises on ne peut plus tape-à-l’œil. Un marché en plein vent avec marchands de plats tout prêts à être mangés ; mais cette ville ne me paraît pas avoir le cachet de Naples. Les palais, maisons ou autres sont moins importants, et bien moins décoratifs : cela ne vaut pas les beaux palais de Gênes.

Les montagnes autour de Palerme sont couvertes de neige, et il est probable qu’il n’y a pas longtemps qu’elle est tombée. Les rues sont boueuses, et les habitants tout emmitouflés. Mais que de cris, et que les voix sont gutturales !
(à suivre…) -
La prière (2)
La prière est exaucée.

Quand Jésus affirme « demandez et on vous donnera » ou « qui demande reçoit », il ne se place pas dans notre cadre temporel. Il ne nous dit pas : « Demandez et vous recevrez ce que vous avez demandé », pas plus que « demandez et vous recevrez sur le champ ». Non. Ce qu’il affirme, c’est que nous recevrons. Quoi ? Ce qui nous convient le mieux. Pouvons-nous oublier que Dieu est notre Père, un Père qui aime ses enfants d’un Amour infini, bien plus que ne peuvent le faire tous les pères et toutes les mères du monde, un Père qui veut le bien de ses enfants, là aussi mieux que tous les pères et les mères du monde, un Père qui sait de science exacte ce qui convient à chacun de ses enfants, un Père qui choisit donc pour nous effectivement ce qui nous convient le mieux à chaque instant et qui ne se trompe jamais dans son choix, autrement il ne serait pas notre Dieu infiniment Bon et Parfait ? Autrement dit, la situation qui est la nôtre à un moment donné, qu’elle nous apparaisse simple ou problématique, qu’elle soit marquée par la bonne santé ou la maladie, qu’elle nous apporte des joies ou des souffrances, est la situation à laquelle Dieu pense pour nous de toute éternité dans son Amour illimité, et donc la situation appropriée, idéale même pour nous sanctifier. Il ne peut pas y en avoir de meilleure, sauf à douter de la bonté paternelle de Dieu. Y songer ne peut que nous remplir d’optimisme et de reconnaissance face à la vie que Dieu nous donne de vivre.
Nous avons vu ce que nous recevrons comme réponse à notre prière. Demandons-nous maintenant quand nous serons exaucés. Rarement dans l’immédiat. « Il leur dit une parabole pour montrer qu’il fallait prier toujours, sans jamais se lasser » (Luc 18, 1). C’est la parabole de la veuve et du juge inique. La veuve en question réclame justice jour après jour à la porte du cabinet du juge et ce dernier ne se résout à l’écouter que pour qu’elle cesse de le bassiner. La conclusion que Jésus en tire est la suivante : « Écoutez ce que dit ce juge inique ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui nuit et jour, et avec eux il referait attendre ? » (Luc 18, 6-7). Cette parabole nous montre bien que notre prière s’inscrit naturellement dans la durée. Mais elle présuppose la foi. Elle n’est ni un automatisme, ni une simple bouée de sauvetage. La prière devrait être une habitude chez nous. « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom : demandez et vous recevrez, si bien que votre joie sera complète » (Jean 16, 24). Jean-Paul II déclarait un jour : « Face aux tragédies des hommes, les prières peuvent sembler inefficaces et vaines ; bien au contraire, elles ouvrent toujours de nouveaux chemins d’espérance, surtout lorsqu’elles sont mises en valeur par la douleur qui se transforme en amour » (Jean-Paul II, Discours aux jeunes et aux éducateurs de l’Institut Séraphique, Assise, 9 janvier 1993), la souffrance, la mortification étant la prière du corps.
En tout cas, il est bon de nous arrêter à réfléchir sur la place que la prière occupe dans notre journée, et de voir si nous savons consacrer vraiment un temps précis à une heure donnée au Seigneur et, par la récitation du chapelet, aussi à notre Mère du ciel. Ce qui nous arrive peut-être, c’est que nous prions peu et mal, et que notre fréquentation de Dieu est réduite à sa plus simple expression alors que nous sommes heureux de nous retrouver avec nos semblables : conjoint, enfants, collègues de travail, amis, pour qui nous avons du temps et à qui nous avons des choses à dire…
(à suivre…) -
La prière (4)
Les formes de prière (suite)

La vie transformée en prière. D’où une autre forme de prière qui est l’offrande à Dieu de tout ce que nous faisons, transformant tout en prière, comme « le roi Midas, qui changeait en or tout ce qu’il touchait », ainsi que le fondateur de l’Opus Dei le faisait remarquer (Amis de Dieu, n° 221). « Vie intérieure, tout d’abord : bien peu comprennent encore ce mot. Quand on entend parler de vie intérieure, on pense à l’obscurité du temple, quand ce n’est pas à l’atmosphère raréfiée de certaines sacristies. Depuis plus d’un quart de siècle, je dis que ce n’est pas cela. Je parle de la vie intérieure des chrétiens courants, que l’on rencontre habituellement en pleine rue, à l’air libre, et qui, dans la rue, à leur travail, dans leur famille, dans leurs moments de loisir demeurent, tout au long du jour, attentifs à Jésus-Christ. Qu’est-ce que cela, sinon une continuelle vie de prière ? N’as-tu pas compris qu’il te fallait être une âme de prière, grâce à un dialogue avec Dieu qui finit par t’assimiler à Lui ? » (saint Josémaria, Quand le Christ passe, n° 8). « Travailler ainsi, c’est prier. Étudier ainsi, c’est prier. Faire ainsi de la recherche, c’est prier ; nous n’en sortons jamais ; tout est prière, tout peut et doit nous mener à Dieu, nourrir ce dialogue continuel avec Lui, du matin au soir. Tout travail digne peut être prière ; et tout travail qui est prière est apostolat. C’est ainsi que l’âme s’affermit, dans une unité de vie simple et solide » (Ibid., n° 10).
L’oraison jaculatoire. Il existe encore une autre façon de prier, qui est l’oraison jaculatoire, du latin jaculum, « javelot », « dard ». Invocation courte et fervente, telle une flèche d’amour à l’adresse de Dieu ou d’un de ses saints, qui peut être lancée, presque comme des pointes enflammées, par exemple contre les tentations, et qui manifeste aussi les sentiments du cœur : actes d’amour, de contrition, de réparation, actions de grâces, manifestation de notre filiation divine… Les textes de l’Écriture Sainte peuvent nous servir pour nous faire nos oraisons jaculatoires, adaptées aux besoins de notre âme, au temps liturgique,etc. Par exemple, « Seigneur, augmente en nous la foi » (Luc 17, 5), « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir » (Luc 5, 12), « Seigneur, que je voie » (Luc 18, 41) ; « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t’aime » (Jean 21, 17) ; « Seigneur, apprend-nous à prier » (Luc 11, 1) ; « je crois Seigneur, mais viens en aide à mon peu de foi » (Marc 9, 23) ; « Maître, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit » (Matthieu 8, 8) ; « mon Seigneur et mon Dieu » (Jean 20, 28) ; « Abba ! Père » (Marc 14, 36) ; « je puis tout en celui qui me fortifie » (Philippiens 4, 13) ; etc.
La mortification. L’homme ne peut pas se sanctifier de façon désarticulée. Étant composé d’une âme et d’un corps, ce dernier doit aussi y contribuer. C’est le propre de la mortification, qui est la prière du corps, le sel de notre vie, une privation, ou souffrance, que l’on s’impose librement pour un motif spirituel.
« La meilleure des mortifications est celle qui, s’appuyant sur des petits détails tout au long de la journée, s’attaque à la concupiscence de la chair, à la concupiscence des yeux et à l’orgueil. Mortifications qui ne mortifient pas les autres, mais qui nous rendent plus délicats, plus compréhensifs, plus ouverts à tous. Tu ne seras pas mortifié si tu es susceptible, si tu n’écoutes que ton égoïsme, si tu t’imposes aux autres, si tu ne sais pas te priver du superflu et parfois même du nécessaire, si tu t’attristes quand les choses ne vont pas comme tu l’avais prévu; en revanche, tu es mortifié si tu sais te faire tout à tous, pour les gagner tous (1 Corinthiens 9, 22) » (saint Josémaria, Quand le Christ passe, n° 9). La mortification « ne saurait consister en de grands renoncements, qui d’ailleurs se présentent rarement. Il doit s’agir plutôt de petites luttes : sourire à qui nous importune, refuser au corps les caprices de biens superflus, nous habituer à écouter autrui, faire fructifier le temps que Dieu met à notre disposition... Et tant d’autres détails, insignifiants en apparence, qui surgissent sans que nous les cherchions — contrariétés, difficultés, chagrins — au fil de chaque jour » (Ibid., n° 37).
(à suivre…) -
ancêtres (4)
Liliane Guerry (1916-2006), docteur ès lettres, directrice du département d’esthétique au CNRS, créatrice et directrice de la collection L’esprit et les formes (Klinksieck), auteur d’ouvrages sur l’esthétique, dont Jean Pélrein Viator, sa place dans l’histoire de la perspective (Les Belles lettres), Fresques romanes de France (Hachette), ou Cézanne et l’expression de l’espace (Albin Michel, 2e éd., 1995). Médaille d’or du CNRS. Liliane Guerry était la femme de Marcel Brion.
Prince Ferdinand de Lacerda (1254-1275), de Castille et Léon.
Alban Laibe (1881-1956). Ancien élève de l’X (promotion 1902), Alban Laibe avait été officier au Sahara de 1908 à 1912. Il écrivit des notes de route sur son aventure saharienne, Au pays des hommes voilés (ce texte se trouve sur ce site, avec des photos de l’auteur). Il fonda en 1922 à Paris l’Agence Coloniale Française, qui publiait un quotidien du soir d’informations économiques et financières intitulé Agence française & coloniale et un hebdomadaire, La Semaine coloniale. Il est le dernier Français à avoir rencontré Charles de Foucauld avant qu’il ne soit tué. Officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre de l’Etoile d’Anjouan et du Nichan Iftikar, croix de Guerre 1914-1918, médaille coloniale.
Joachim Lebreton (1760-1819, mort au Brésil), membre du Tribunat, membre de l’Institut (dès sa création), un des organisateurs du musée du Louvre. Il fut le premier Secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux Arts. S’étant opposé avec véhémence à la Restauration contre la confiscation des collections du Louvre voulue par Wellington et contre la restitution des œuvres saisies par Napoléon, il s’exila au Brésil avec un groupe de peintres et d’artistes. Il y fonda une Académie des Beaux Arts, dont il fut premier Secrétaire perpétuel. Il publia plusieurs ouvrages de rhétorique.
Marcel le Tourneau (1874-1912), architecte DPLG et archéologue, expert près la Cour d’appel de Paris. Après plusieurs voyages d’étude en Italie, Grèce (Météores et Thessalie), Liban, Tunisie et Turquie, il fut chargé de missions scientifiques par le Gouvernement français à Salonique (alors dépendant de l’Empire ottoman), "relatives à l’archéologie byzantine". Au cours de celles-ci (en 1905, 1907, 1908, 1909 et 1910), il découvrit et restaura les célèbres mosaïques. Il donna à l’Académie des Beaux Arts des communications sur ses travaux et il publia des ouvrages. Certaines mosaïques de Salonique disparurent dans le grand incendie qui ravagea cette ville en 1918, de sorte que leur représentation ne subsiste que par les clichés et les aquarelles de Marcel le Tourneau.

Jean-Jacques (dit James) Pradier (1790-1852), statuaire très célèbre dès son vivant, ami de tous les artistes et écrivains de son époque, membre de l’Académie des Beaux Arts. Officier de la Légion d’honneur. On lui doit, entre autres, les douze victoires du tombeau de Napoléon aux Invalides, Sapho (Musée d’Orsay), les statues de Lille et de Strasbourg sur la place de la Concorde à Paris, les renommées sur l’Arc de Triomphe, des sculptures au Sénat, une Pietà à Notre-Dame de la Garde à Marseille, sept stations du Chemin de Croix dans la basilique Sainte-Clotilde, à Paris, une Vierge dans la cathédrale Notre-Dame des Doms à Avignon pour laquelle sa femme, Louise d’Arcet, aurait servi de modèle, etc.

Guillaume Rouelle (1703-1770), membre de l’Académie des sciences, des Académies d’Erfurt et de Stockholm, professeur de chimie au Jardin du Roi (Diderot, Lavoisier, Malesherbes, Rousseau, notamment, suivirent ses cours).
Hilaire Rouelle (1718-1799), frère du précédent, chimiste, membre de l’Académie des sciences, professeur de chimie au Jardin du Roi (poste où il succéda à son frère).